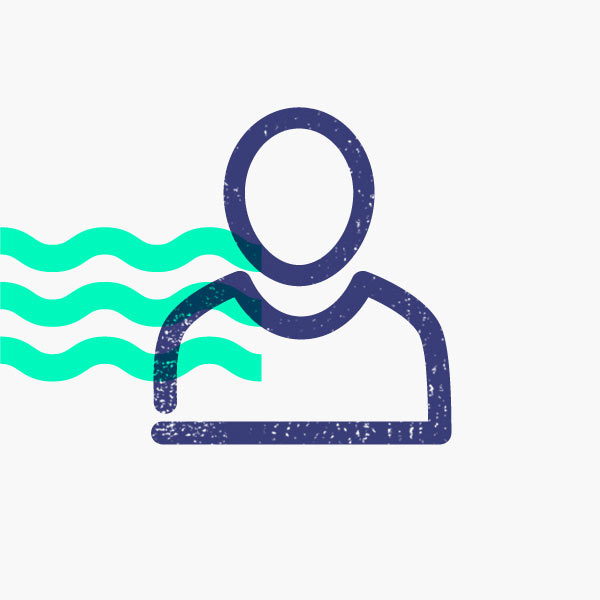L’enseignement de la littérature. Aspects critiques et historiques. Première partie: Le cours classique
Max Roy est professeur au Département d’études littéraires de l’UQAM et membre du Centre de recherche Figura sur le texte et l’imaginaire. Il s’intéresse aux théories et aux pratiques de la lecture dans une perspective critique et didactique. ses recherches récentes, réalisées par mode d’enquêtes auprès du lectorat québécois, portent sur la formation des lecteurs et les conceptions d’une culture littéraire.
M. Roy a aussi été professeur au cégep de Limoilou (1993-1994). Depuis plusieurs années, il étudie la question de l’enseignement de la littérature au Québec, en particulier à l’ordre collégial. Ses principales publications sur le sujet sont :
« Le renouveau scolaire : la recherche d’une culture commune et pratique », dans Que vaut la littérature ? Littérature et conflits culturels (D. Saint-Jacques, dir.), Québec, Nota Bene, 2000.
La littérature québécoise au collège [1990-1996], Montréal, XYZ éditeur, 1998.
La littérature au cégep [1968-1978] (J. Melançon et C. Moisan, codir.), Québec, Nuit blanche, 1993.
Le discours d’une didactique. La formation littéraire dans l’enseignement classique au Québec [1852-1967] (avec J. Melançon et C. Moisan), Québec, Nuit blanche, 1988.
Les critiques récurrentes sur l’état de la langue et de la culture chez les jeunes adultes pointent invariablement les milieux de l’éducation. Ceux-ci, si l’on se fiait à l’opinion publique, seraient responsables de presque tous les maux. En effet, l’échec du système d’enseignement est un lieu commun quasi permanent et qui, curieusement, sert aussi bien à contester qu’à justifier les réformes de programmes. Il faut compter avec le temps, bien sûr, pour évaluer les effets d’un changement. Mais pour être valable, cette appréciation doit tenir compte de la variation du contexte et des objectifs des réformes. À partir de recherches sur la situation passée et actuelle dans ce domaine au Québec, je propose ici un bilan critique et historique de l’enseignement de la littérature dans le cadre de la formation préuniversitaire. En soulignant quelques particularités des programmes, des finalités et des pratiques scolaires, j’indiquerai les enjeux des réformes successives jusqu’à nos jours. On verra qu’il existe une certaine continuité dans les programmes, au-delà des différences culturelles et méthodologiques.
Des articles à venir feront état de l’enseignement collégial et d’enquêtes récentes sur les habitudes de lecture des collégiens. Dans le présent article, je décrirai la formation littéraire dans le régime du cours classique, qui a précédé la création des cégeps. Il est utile de connaître cet horizon culturel, parce qu’il a souvent servi de référence dans les discussions sur l’enseignement de la littérature et que certaines pratiques contemporaines rappellent étrangement le passé.
Des enjeux multiples
L’École a toujours été le lieu privilégié de perfectionnement de la langue maternelle ou d’apprentissage d’une langue seconde. C’est une évidence. Toutefois, l’étendue de l’influence scolaire et de ses applications est diversement comprise et appréciée. Selon des énoncés explicites dans la plupart des programmes, l’étude de la langue permet d’améliorer les communications et les relations sociales ; elle produit un savoir utile pour le travail ; elle donne accès à une pensée complexe et à un univers symbolique ; elle ouvre au domaine esthétique… À travers elle, on vise l’acquisition de connaissances générales et le développement d’habiletés de lecture et d’écriture – que l’on espère voir devenir des habitudes. De plus, on fait évidemment la promotion d’une culture conçue selon des « standards » qui semblent s’imposer par leur valeur d’usage. La littérature en est une forme privilégiée, mais qui est rarement enseignée pour elle-même. À toutes les époques, la langue comme discipline scolaire est associée à de larges enjeux. C’est tantôt la formation des élites, tantôt l’affirmation d’une identité collective, tantôt encore un équilibre social ou un positionnement sur l’échiquier « mondial ». Pourtant, les fins auxquelles on destine l’étude de la langue et de la littérature varient peut-être moins que l’on pense, en dépit des justifications de réformes et des formulations renouvelées dans les instructions officielles. En fait, il s’agit généralement d’atteindre, au-delà de l’École, des usages sociaux, de sorte qu’une visée pragmatique s’ajoute presque toujours à la transmission des connaissances. La présence de la littérature dans l’enseignement préuniversitaire se justifie moins par sa valeur intrinsèque et esthétique que par sa fonction de modèle et d’instrument d’apprentissage. C’était le cas au XIXe siècle ; ça l’est encore aujourd’hui.
L’enseignement collégial : un changement de culture
Les cégeps sont nés, on le sait, à la suite des travaux de la commission Parent – du nom de son président –, qui en recommandait l’implantation avec celle des écoles secondaires publiques (les « polyvalentes ») et du réseau de l’Université du Québec. Avec la création du ministère de l’Éducation, en 1964, la réforme du système d’éducation a constitué l’une des réalisations majeures de la Révolution tranquille. Son objectif principal était la démocratisation de l’enseignement, ce qui entraînerait, pour les générations futures, une hausse du niveau de scolarité et des qualifications professionnelles. Outre la nécessité de créer un réseau d’enseignement public qui donne accès à l’Université, le projet visait l’amélioration de la formation générale de l’ensemble de la population étudiante. La critique du système d’enseignement alors en place et, particulièrement, de l’état de la langue parlée encourageait la poursuite de ce but. C’était plus qu’un changement administratif et structurel, c’était un changement de mentalité et, à proprement parler, un changement de culture. La formation générale devenait universelle et elle devait inclure le présent. Les espoirs et les attentes étaient énormes, entre autres à l’égard des savoirs linguistiques et littéraires, qui conservaient une place centrale dans les nouveaux programmes. On pouvait imaginer l’effet positif du changement : la population serait de plus en plus instruite et cultivée ; les pratiques de lecture seraient plus répandues ; les valeurs intellectuelles auraient plus de prestige… Si cela se vérifie globalement, à long terme et selon des critères contemporains, il reste que les déceptions, les critiques et les remises en question étaient probablement inévitables. Elles s’expliquent peut-être par une idéalisation de la formation générale ou par une inadéquation entre la culture vivante et la culture de référence.
Il faut savoir ce que représentait, avant la création des cégeps, la culture lettrée, que l’on voulait à la fois largement dispenser et dépasser. Sous le régime antérieur – plus que séculaire –, la formation classique était réservée aux élèves des séminaires et collèges privés et elle reposait sur l’universalité des Grandes Œuvres, consacrées par le temps. Inauguré en 1635, au Québec, par le Collège des Jésuites, le cours classique poursuivait explicitement des objectifs de formation religieuse et civique en ouvrant la voie au sacerdoce et aux professions libérales. Au XIXe siècle encore, selon un programme régi par l’Université Laval, depuis 1853, on y enseignait le grec et le latin, mais aussi la langue française, dans ses différents aspects. Après sept années d’école primaire, le cours classique comprenait huit années d’études : six années consacrées aux Humanités et deux années réservées à la philosophie et aux sciences. L’étude de la syntaxe et de la versification était au programme des classes d’Humanités, dont les deux dernières années, les classes de lettres par excellence, étaient appelées Belles-Lettres et Rhétorique. Cette dernière était considérée, selon l’expression de l’historien Claude Galarneau, comme « le couronnement de l’enseignement humaniste[1] ». C’est au terme de cette année, d’ailleurs, que les élèves subissaient l’épreuve de lettres du baccalauréat, dont la responsabilité revenait aux universités. L’étude des belles-lettres et de la rhétorique indique un aboutissement voulu des apprentissages. En termes d’années d’études, ces classes correspondent à peu près, de nos jours, au régime d’enseignement général dans les collèges québécois. Mais leurs contenus, leurs méthodes et leurs objectifs étaient bien différents.
Le modèle rhétorique
Parmi les différences majeures, il faut rappeler que la notion de littérature avait, au moins jusqu’au XXe siècle, un sens élargi, et qu’elle recouvrait toutes sortes de discours, du sermon au plaidoyer en passant par l’exposé historique. L’objet d’enseignement était alors l’Éloquence, qui se spécifiait en éloquence sacrée, militaire, juridique, politique, etc. À côté des maîtres de l’éloquence – les Démosthène, Bossuet et Fénelon –, les auteurs anciens et les classiques français avaient valeur de modèles. Pour l’étude approfondie de la langue, la rhétorique était la discipline souveraine et la voie d’accès à la littérature. C’est dire que le texte littéraire n’était qu’un exemple parmi d’autres, au mieux un modèle du genre, servant à l’étude des règles de la rhétorique. Cette suprématie de l’ars rhetorica sur l’esthétique littéraire s’observe jusque dans les premières décennies du XXe siècle. Bien sûr, on s’exerçait à la lecture en étudiant la biographie et certaines œuvres marquantes des Grands Auteurs, les Classiques essentiellement, à travers des traités de rhétorique et des recueils de morceaux choisis. Retenus pour leur valeur édifiante, les extraits littéraires étaient accompagnés de jugements critiques qui en fixaient l’interprétation. En général, ces ouvrages contenaient la matière – voire toute la matière – enseignée, alors que les œuvres intégrales étaient peu disponibles. Le rôle du maître en était peut-être facilité, lequel devait se consacrer à la transmission des codes linguistiques, poétiques et rhétoriques. De toutes façons, le savoir-écrire restait l’objectif prioritaire de la formation. En effet, sous la gouverne de la rhétorique, l’étude de la langue et des faits littéraires devait conduire à savoir penser, parler et écrire de manière correcte et efficace, c’est-à-dire convenable et persuasive. Selon la formule consacrée, le bon et le vrai étaient indissociables du beau. Dans les classes de Belles-Lettres et de Rhétorique, les élèves s’exerçaient, avec méthode et régularité, à rédiger des narrations, des portraits, des lettres et des discours de toutes sortes (apologies, harangues, panégyriques…), à la manière d’allocutions publiques. Les sujets de devoirs, fixés d’avance, comprenaient souvent un canevas qu’il s’agissait de développer – la forme canonique en était « l’amplification » – et la matière des compositions au XIXe siècle s’inspirait plus de l’Histoire que des œuvres littéraires. En pratique, les élèves adoptaient les règles de l’éloquence dans les discours écrits. Les meilleurs d’entre eux s’exerçaient à l’art oratoire en prononçant ces discours devant leurs pairs et leurs maîtres dans le cadre d’Académies ou de Sociétés littéraires, constituées dans chacun des collèges et séminaires. En l’occurrence, ceux-ci constituaient un véritable microcosme de la société dont les diplômés du cours classique étaient appelés à devenir l’élite (cette formule est explicite dans le discours de l’Institution). La formation classique à cette époque semble donc tournée surtout vers l’usage social du discours. Sur la base de valeurs humanistes et chrétiennes, dans les collèges et séminaires québécois, on forme des individus – des hommes uniquement alors – capables de s’exprimer en toutes circonstances et de persuader leurs concitoyens. La maîtrise de la langue et la lecture littéraire servent, en définitive, une finalité pragmatique.
Dans les archives des collèges-séminaires, on avait conservé, jusqu’à récemment, des milliers de travaux d’élèves transcrits dans des « cahiers d’honneur ». Lors de recherches en équipe, nous en avons recueilli quelque 3500 qui représentent toutes les formes et tous les sujets de devoirs scolaires dans les classes terminales[2]. Au XIXe siècle, en classe de Belles-Lettres, on écrit le récit de « L’expatriation des Acadiens » (SQ, 1861) ou un « Épisode de l’histoire du Canada. Fait d’armes au Long-Sault en 1660 », qui vante évidemment la bravoure de Dollard des Ormeaux (CSAP, 1879). En classe de Rhétorique, des élèves rédigent une forme d’allocution sur ce sujet : « L’évêque de Saint-Malo, avant de bénir Cartier et ses compagnons, leur adresse la parole… » (SQ, 1862). D’autres s’exercent à composer rien de moins qu’un discours de Mgr de Laval adressé à Louis XIV, le 13 août 1662, pour réclamer l’interdiction du commerce de l’alcool en Nouvelle-France (SSH, vers 1875), ou encore un discours de Bonaparte, en date du 12 avril 1798, qui « propose au directoire la conquête de l’Égypte » (SC, 1878). Il s’agit là, on le comprend, de mises en scène, de simulations de discours qui ont pour but l’apprentissage de l’art oratoire.
Des sujets historiques, religieux et patriotiques apparaissent encore au XXe siècle, alors que d’autres genres de compositions remplacent progressivement la narration et le discours. On trouve, par exemple, des dissertations sur la Révolution française, qui, au dire de Joseph de Maistre, a été « satanique » (SN, 1904), sur « Le mouvement catholique dans la littérature française » (STR, 1931) et sur la valeur de « notre patriotisme » (SQ, 1937). L’un des tout derniers devoirs d’élèves conservés dans les archives du Séminaire de Québec reprend la forme oratoire du discours et a pour sujet : « L’attitude d’un étudiant du XXe siècle en face des valeurs essentielles du patrimoine national » (SQ, 1964). La tradition rhétorique ne s’est pas totalement éteinte et on assiste encore à une dramatisation de l’histoire dans les rédactions françaises. Des compositions datées sur la suprématie de l’Église en toute matière, sur les lois divines et le destin des femmes ne laisseraient personne indifférent. Il faut replacer ces devoirs dans leur contexte historique et institutionnel et tenter de saisir les buts recherchés par les éducateurs catholiques. Les sujets sont désuets, la méthode aussi, du moins en apparence. De nos jours, on encourage bien, quelquefois, des formes de débats en classe, qui font appel à la rhétorique persuasive ; les élèves sont alors appelés à prendre position sur des sujets d’actualité, comme les élèves du XIXe siècle se prononçaient sur des sujets d’histoire. Mais les exercices de rédaction actuels font penser davantage à un autre modèle, que nous décrirons maintenant.
Le modèle de l’histoire littéraire
À la suite des travaux de Gustave Lanson, fondateur de la méthode scientifique de l’histoire littéraire, l’enseignement de la littérature se transforme profondément au XXe siècle. Amorcée plus tôt en France, la mutation s’opère graduellement au Québec, où persiste l’influence de la rhétorique. C’est un changement de paradigme épistémique. Le modèle critique de l’histoire littéraire remplace le modèle pratique de la rhétorique. On semble passer d’un objectif pragmatique (savoir écrire) à un objectif cognitif (savoir lire). Les visées civiques et morales – catholiques, en fait – prédominent toujours, mais les œuvres littéraires sont l’objet d’une attention grandissante. Ainsi, les traités de rhétorique cèdent la place aux manuels d’histoire littéraire. Si on continue à étudier la versification et les figures de style, on s’intéresse de plus en plus aux courants littéraires et aux mouvements esthétiques, aux biographies et aux générations d’écrivains. De même, les exercices scolaires typiques changent : la narration fait place à l’analyse littéraire en classe de Belles-Lettres et le discours historique s’efface devant la dissertation en Rhétorique. Ce sont les deux modèles dominants de compositions scolaires au XXe siècle.
Les dissertations et analyses littéraires ne s’imposent véritablement en nombre qu’au tournant des années 1930, ce qui confirme que les œuvres étaient peu lues et peu étudiées auparavant, du moins dans leur intégralité. Celles-ci avaient tout au plus valeur de modèles et de références. On se méfie encore de la lecture, en 1940, comme l’atteste ce sujet de composition : « Est-il vrai de dire de la lecture ce qu’Ésope disait de la langue : »est la meilleure et la pire des choses » ? « (SQ). Un sujet de devoir pose la question : » Pourquoi l’étude des auteurs français ? « (SQ, 1940). Un autre : » Y a-t-il quelque profit à retirer de l’étude de la littérature française ? « (SQ, 1946). La promotion des » bonnes lectures « comporte un alignement sur des valeurs traditionnelles. La littérature française n’est reçue et n’est acceptable que dans sa forme classique, qui puise aux sources de la culture gréco-latine. C’est un fait connu que les classiques français dominent largement, tandis que les œuvres romanesques et les auteurs contemporains se font rares, que seuls quelques écrivains romantiques (Hugo, Chateaubriand, Lamartine) retiennent l’attention et que les philosophes des Lumières, les réalistes et les naturalistes sont quasi absents. C’est aussi un fait connu que les symbolistes entrent tardivement au programme. Plusieurs générations d’élèves sont appelées à se prononcer sur » le caractère de L’Avare « (SQ, 1902, 1940, 1950, 1962) et plus encore sur Les femmes savantes (SQ, 1908, 1922, 1930, 1941, 1957) et, partant, sur l’instruction des femmes… Dans ce panthéon, Racine est mieux représenté que Molière. Andromaque, Britannicus et surtout Athalie sont l’objet répété de dissertations et d’analyses littéraires. L’importance d’Athalie est manifeste durant toute la période de l’enseignement classique en raison de son caractère religieux. De nombreuses compositions établissent, par ailleurs, une comparaison entre Racine et Corneille. D’après les documents d’archives, celui-ci serait l’écrivain classique par excellence. On a analysé Polyeucte ; on a disserté sur le patriotisme dans Horace et, surtout, on a étudié Le Cid. Cette œuvre représente, en effet, le sujet proprement littéraire le plus fréquemment traité dans les compositions scolaires.
Il serait fastidieux de dresser une liste de sujets de devoirs récurrents qui prennent la forme de portraits, de parallèles et de discussions sur les mérites des grands auteurs, ceux des héros cornéliens ou ceux de l’Art poétique de Boileau. Il faudrait, en revanche, une étude minutieuse pour comprendre la lente inclusion de la littérature canadienne-française dans la culture scolaire, à partir des sujets d’histoire d’abord, puis favorisée par le célèbre manuel de Camille Roy[3]. Après les orateurs illustres, comme Papineau et L.-H. La Fontaine, quelques écrivains québécois ont occupé une place modeste, mais notable dans l’enseignement : Garneau, Fréchette, Crémazie, Lozeau, Gérin-Lajoie, Beauchemin et DesRochers. Quant à Nelligan, il est vite devenu, et bien malgré lui, un auteur scolaire.
Remplaçant les hauts faits de l’Histoire qui inspiraient les narrations et les discours rhétoriques, les morceaux choisis invitent à une réflexion rigoureuse. Les exercices de jugement que sont les dissertations insistent sur la valeur du plan. Ils se distinguent par une rigueur de l’argumentation, ce qui implique un système logique de preuves qui l’emporte alors sur les mœurs oratoires. Le discours rhétorique contenait en germe un parcours argumentatif ; le discours critique en fait son principe d’existence. Dans les faits, la rationalité et l’objectivité dans les dissertations d’élèves résistent mal à un examen sérieux. Celles-ci sont, le plus souvent, la répétition d’une thèse et, dans le contexte des collèges-séminaires, l’affirmation des valeurs humanistes et religieuses. Faut-il rappeler que l’analyse et la dissertation littéraires sont des exercices de rédaction ? Elles ont été conçues à des fins didactiques et pratiques. Leur rendement n’est pas fonction d’un contenu, mais de la technique qu’elles permettent d’acquérir.
La méthode de lecture
Il faut dire au moins quelques mots sur la méthode de lecture proposée. Pour enseigner comment écrire, les éducateurs humanistes disposaient de la rhétorique, un art qui réglait tout le discours, depuis la recherche des idées (inventio) jusqu’à l’organisation des parties (dispositio) et la forme d’expression (elocutio). Pour la lecture, ils pouvaient faire appel à une méthode qui avait également fait ses preuves : l’explication de textes. Celle-ci devient alors un véritable modèle de lecture. Appelée aussi » lecture expliquée », cette activité dirigée par l’enseignant en classe indique l’attitude à adopter à l’égard des textes. La méthode est calquée sur la praelectio, un exercice central dans la pédagogie des Jésuites mis au point pour l’enseignement du latin. Traditionnellement, l’explication se fait selon cinq points : l’exposé du sujet ; l’interprétation qui vise, dit-on, à établir la « vérité du texte « (notamment par une explication du vocabulaire) ; la rhétorique ou la grammaire ; l’érudition (qui fait apparaître le contexte) et le style (autrefois la » latinité »). Le maître reste la source du savoir. Dans l’enseignement humaniste, l’explication se conclut généralement sur la leçon morale du texte à l’étude. On aura compris que le texte est un objet à déchiffrer, un problème à résoudre, avant d’être l’occasion d’une expérience émotive ou esthétique.

D’une époque à l’autre, les œuvres et les connaissances littéraires ont été vues à travers le prisme de la rhétorique et de l’histoire littéraire. Celles-ci proposaient la sélection ainsi que la hiérarchie des objets de savoir. Le sens et la valeur des œuvres en dépendaient, tout autant que la valeur de la formation littéraire dépendait du système en place. Avec la création des cégeps, un nouveau programme d’enseignement du français évinçait le cours classique. On voulait peut-être moins faire table rase du passé que promouvoir de nouvelles idées et de nouveaux objets, mais l’effet a été radical. Les contenus, les méthodes et même le matériel documentaire (les manuels) ont presque totalement changé en peu de temps. Néanmoins, l’enseignement littéraire a conservé une finalité pragmatique qui faisait autrefois la toute-puissance de la rhétorique : montrer aux élèves à bien s’exprimer. D’ailleurs, le savoir-écrire l’emporte toujours sur la culture littéraire.
Sur le plan pratique surtout, des similitudes apparaissent entre les programmes, même si les méthodes et les références ont changé. Dans une certaine mesure, l’influence de la linguistique et des théories de la communication, à partir de 1970, s’apparente à celle de la rhétorique. Plus près de nous, un certain retour des classiques dans la formation générale commune a commandé aussi le retour en force des manuels d’histoire littéraire. Enfin, le programme de 1993 – dit le Renouveau – a réintroduit dans l’enseignement des exercices de rédaction classiques : l’analyse littéraire et la dissertation. Il en sera question dans un prochain article consacré à l’histoire de l’enseignement littéraire dans les cégeps.

- Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français, Montréal, Fides, 1978, p. 45. Retour au texte
- Voir à ce propos : Joseph Melançon, Clément Moisan et Max Roy, Le discours d’une didactique. Les processus de formation littéraire dans l’enseignement classique au Québec (1852-1967), Québec, Nuit blanche éditeur, CRELIQ/Université Laval, collection « Recherche », no 1, 1988 ; Max Roy, « Le discours didactique : un lieu inaugural des valeurs littéraires », Thèse de doctorat, Faculté des lettres, Université Laval, 1991.La provenance et la date des compositions sont indiquées entre parenthèses, avec les sigles qui suivent : SQ (Séminaire de Québec), CSAP (Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière), SSH (Séminaire de Saint-Hyacinthe), SC (Séminaire de Chicoutimi), SN (Séminaire de Nicolet), STR (Séminaire de Trois-Rivières). Il serait facile de multiplier les exemples et les références à plusieurs autres établissements. Retour au texte
- Le Manuel d’histoire de la littérature canadienne a été publié en 1918 ; il a connu une vingtaine de rééditions jusqu’en 1945 et il a été utilisé, dans certains collèges, jusqu’en 1960. Retour au texte
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications