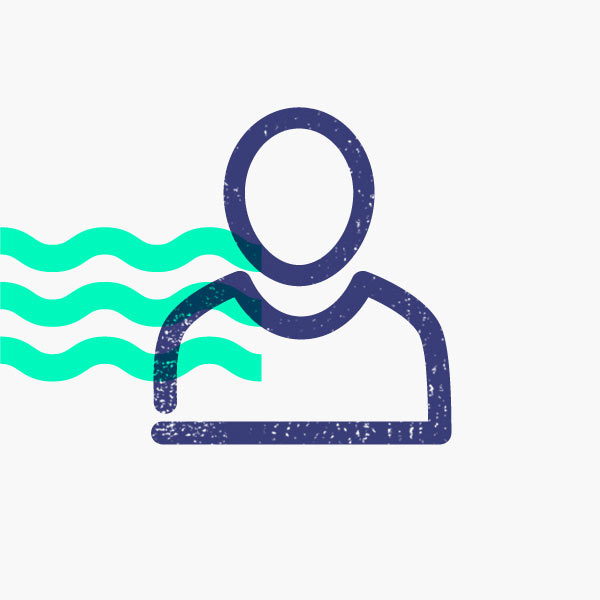L’épreuve uniforme: mythes et réalités
Rappel de quelques faits
Beaucoup de critiques et d’opinions diverses ont été exprimées dans les médias à la suite de la publication par le ministère de l’Éducation des taux de réussite à l’épreuve uniforme de français de 1997-1998. Nous tentons ici de mettre les pendules à l’heure en corrigeant certains préjugés et en pointant certains mythes qui entourent cet examen que, depuis 1998, doivent réussir les cégépiens pour obtenir leur diplôme d’études collégiales.
Rappelons que l’épreuve consiste en la rédaction d’une dissertation d’au moins 900 mots sur une problématique portant sur un ou deux textes littéraires. L’élève dispose de quatre heures trente minutes pour accomplir cette tâche : lire les textes littéraires soumis, choisir un sujet de rédaction parmi trois, comprendre la question, analyser le ou les textes littéraires associés au sujet retenu, choisir un point de vue à défendre, préparer un plan de rédaction, rédiger et corriger sa dissertation.
Rappelons également que le but de cette épreuve n’est pas de mesurer une performance littéraire par un examen sur les connaissances acquises, mais bien de s’assurer que l’élève candidat au D.E.C. a les compétences minimales, en lecture (compréhension de textes et de consignes) et en écriture (organisation des idées, rédaction et maîtrise de la langue). Il ne s’agit pas de situer l’élève par rapport à une perfection théorique, mais bien de mesurer s’il a atteint le seuil de ce qu’on est en droit d’attendre d’un élève ayant un peu plus de douze ans de scolarité. Pour ce faire, trois critères sont pris en considération : le contenu, l’organisation des idées et la maîtrise de la langue. L’élève doit obtenir la note de passage à chacun de ces critères. Signalons enfin que l’épreuve a lieu trois fois par année : à la fin des trimestres d’automne et d’hiver, et au mois d’août.
Examinons certains « mythes » en tentant de corriger les préjugés qu’ils entretiennent.
Mythe. Les copies des élèves sont corrigées par des étudiants de l’ordre universitaire inexpérimentés qui ne connaissent pas le milieu collégial.
Réalité. Au contraire, les correcteurs de l’épreuve de français détiennent au minimum un diplôme de premier cycle et sont tous encadrés par des enseignants de cégep.
Les correcteurs sont très compétents et reçoivent une formation précise pour procéder à une évaluation minutieuse. La plupart ont plusieurs années d’expérience dans la correction de copies d’élèves du secondaire et du collégial et ont également corrigé les épreuves antérieures. Tous les correcteurs reçoivent une formation à chaque session de correction et les tout nouveaux, une formation supplémentaire. La moyenne d’âge des correcteurs de la cohorte de 1999 est de 37 ans. Ils sont tous diplômés universitaires, ont souvent une maîtrise et même un doctorat. Certains enseignent au trimestre d’automne dans des cégeps ou donnent des cours d’été. D’autres sont réviseurs linguistiques, rédacteurs, écrivains, traducteurs ou travailleurs à la pige dans des domaines souvent reliés à la littérature. Ils ont une bonne connaissance des caractéristiques et capacités des cégépiens. Laisser entendre qu’ils ne sont pas aptes à faire leur travail, c’est manquer de respect à l’égard de leur compétence et de leur professionnalisme.
Mythe. Il est impossible que le taux de réussite des élèves soit passé de 60 % (ancien test d’entrée à l’université) à plus de 85 % (épreuve uniforme actuelle).
Réalité. Les élèves qui se présentent à l’épreuve sont plus forts en français que ceux qui subissaient le test avant la réforme de 1995.
Le taux de réussite à l’épreuve actuelle ne peut en rien être comparé au taux de réussite au test de français qui était en vigueur avant la réforme, puisque les deux examens n’exigent pas la même tâche et ne sont pas évalués sur les mêmes bases ni à partir des mêmes critères. On peut s’étonner d’ailleurs qu’on accorde aujourd’hui de la crédibilité à cet ancien test (comme s’il était un reflet juste de la maîtrise de la langue) qui, à l’époque, avait été critiqué au point qu’on reconnaissait unanimement qu’il fallait le remplacer par un instrument d’évaluation en lien plus étroit avec la formation réelle des élèves. Dans les faits, plusieurs différences entre les deux examens ne permettent pas, en toute honnêteté, de faire des rapprochements entre les deux taux de réussite. D’abord, l’épreuve actuelle s’adresse à tous les étudiants candidats au D.E.C., contrairement au test de français qui n’était obligatoire que pour les seuls élèves désirant être admis dans une faculté universitaire. De plus, l’évaluation du fond et de la forme, incluant la maîtrise de la langue, a été radicalement modifiée pour tenir compte des nouveaux objectifs de l’enseignement collégial. L’épreuve actuelle porte sur ce que les élèves sont censés avoir appris dans leurs trois premiers cours de français (analyse littéraire, dissertation explicative et dissertation critique) alors que l’ancien test de français était un texte d’opinion que l’élève n’avait exercé qu’en cinquième secondaire, soit deux ou même trois ans après sa formation.
Il ne faudrait pas non plus négliger le fait que la réforme de 1995 a augmenté le nombre d’heures de cours (les trois premiers cours sont passés de 45 à 60 heures) et a ajouté des objectifs directement reliés aux habiletés langagières. Les élèves reçoivent une formation plus directement reliée à la compétence évaluée en fin de parcours et consacrent une attention beaucoup plus soutenue à la rédaction et aux méthodes de correction de leurs textes. Il apparaît donc normal que les élèves réussissent mieux à l’épreuve actuelle qu’au test en usage de 1992 à 1996. Les élèves reçoivent à présent plus de 180 heures d’enseignement de la littérature et de la langue, ils ont lu au moins de 8 à 12 oeuvres littéraires, ils ont écrit entre 30 et 60 pages de textes du même type que la dissertation de l’épreuve. L’ancien régime n’avait pas de telles exigences.
Mythe. Les résultats sont élevés parce que l’épreuve est trop facile.
Réalité. Ni la formation, ni les travaux, ni les examens, ni l’épreuve finale ne peuvent être qualifiés de faciles.
Pour beaucoup d’élèves, la marche est haute : passer des exigences du secondaire à celles du cégep fait en sorte que, à travers le Québec, 40 % des élèves ne réussissent pas du premier coup le cours d’analyse littéraire qu’ils reçoivent au début de leur formation collégiale ; les plus faibles doivent même faire au préalable un cours de mise à niveau. C’est donc dire que certains élèves se présenteront à l’épreuve après avoir suivi de 240 à 300 heures de cours de français. Le moins qu’on puisse espérer, c’est qu’ils réussissent. Et s’ils le font, qu’on s’en réjouisse : c’est qu’ils auront pu, au cégep, combler des lacunes qu’ils n’étaient pas parvenus à combler au secondaire. Mais ajoutons que là aussi les choses s’améliorent : les conditions d’admission au cégep ont été resserrées et devraient éviter que des élèves fassent du sur-place avant de pouvoir se présenter à l’épreuve de français.
Mythe. Les résultats sont bidon, le taux de réussite étant faussé au moment de la correction par un laxisme inacceptable.
Réalité. Le taux de réussite à l’épreuve est inférieur au taux de réussite en classe.
Le taux de réussite à l’épreuve oscille depuis quatre ans entre 77 % et 90 %, l’épreuve du mois d’août étant celle où beaucoup d’« échoueurs » peuvent se reprendre et où le taux de réussite est le plus faible. Si les résultats sont aussi bidon que certains le prétendent, comment expliquer que le taux de réussite du cours 103, auquel sont inscrits les élèves qui doivent passer l’épreuve, soit dans l’ensemble du réseau collégial de 93 % ? Théoriquement, le taux de réussite à l’épreuve devrait être de 100 % puisque les élèves ont réussi toutes les étapes préalables. Prétendre que l’épreuve uniforme de français ne reflète pas la réalité des performances scolaires, c’est prétendre que la totalité des enseignants du cours 103 sont également dans l’erreur et laissent réussir des élèves qui ne le mériteraient pas.
Le laxisme que certains dénoncent concerne toujours la qualité de la langue écrite. Or, faut-il interdire à un élève l’accès au marché du travail ou à l’université parce qu’il a omis dix fois dans son texte les deux-points devant une citation ? L’exemple paraît singulier, mais c’est ce genre de « laxisme » que certains pointent du doigt et s’empressent de dénoncer. La véritable question qu’il faut se poser est plutôt celle-ci : qu’est-ce que la maîtrise suffisante de la langue écrite ? Appliquer les règles puristes et normatives à la lettre sans tenir compte de la réalité socioculturelle du Québec et de la maîtrise relative attendue d’un élève ayant une scolarité de douze ans ? Faire moins de 30 fautes de tout genre dans un texte de 900 mots ? Maîtriser les participes passés sans être capable d’écrire autre chose que des phrases comportant le moins possible de propositions subordonnées ?
Il faudrait d’abord et avant tout définir ce qu’on doit entendre par le concept de « faute » et il est loin d’être évident que le réseau collégial pourrait faire l’unanimité sur une définition claire et opérationnelle de ce concept. Rappelons, par exemple, les divergences des dictionnaires par rapport aux prescriptions de l’Académie ou les aléas de l’implantation des réformes orthographiques.
La maîtrise de la langue ne peut s’exprimer dans un chiffre indiquant un nombre de fautes commises, peu importe leur nature ou leur gravité. S’il existe, au moment de la correction, une distinction entre fautes majeures et fautes mineures, c’est pour éviter des aberrations qui mettraient un élève en échec (ce qui, rappelons-le, le priverait de son D.E.C.) parce qu’il a omis ou confondu tel ou tel signe de ponctuation plusieurs fois dans son texte ou qu’il met parfois une apostrophe où il n’en faut pas…
Mythe. Les copies sont « réanimées », c’est-à-dire qu’elles sont haussées au-dessus du seuil de réussite alors qu’elles devraient être en échec.
Réalité. La supervision des copies vise à vérifier que la correction est le plus uniforme possible et qu’il n’y a pas d’écart entre les correcteurs.
Toutes les copies en échec sont relues par un, parfois deux ou trois superviseurs dans le but de s’assurer que la mention d’échec est justifiée. À la fin de chaque période de correction, les copies qui échouent en étant tout près des seuils de réussite (de contenu, de structure ou d’expression écrite) sont vérifiées une dernière fois. Cette ultime vérification s’appuie sur un principe d’équité. L’enjeu étant capital, il serait inacceptable de priver indûment un élève de son D.E.C. pour une maîtrise approximative d’un même signe de ponctuation, par exemple. Le but de l’exercice est donc d’assurer une correction juste et non de « normaliser » les résultats, comme certains l’ont laissé entendre.
Mythe. L’augmentation du taux de réussite est d’autant plus surprenante qu’elle s’est produite subitement.
Réalité. Au contraire, cette augmentation a été progressive.
Depuis la première expérimentation, en 1994, le taux de réussite a augmenté progressivement à mesure que la formation des élèves s’est ajustée aux nouvelles exigences, que diverses formes d’aide ont été offertes aux élèves, que cette aide a été mieux adaptée aux exigences de l’examen final, que le troisième cours préalable à l’inscription à l’épreuve a eu comme objectif la maîtrise du même genre de rédaction et que les élèves ont pris cet examen (d’abord expérimental, puis obligatoire et dont la réussite est conditionnelle à l’obtention du diplôme) de plus en plus au sérieux.
En conclusion
De toutes les inquiétudes qu’on manifeste autour de l’amélioration des cégépiens en français, retenons qu’on aura toujours raison de se soucier de la qualité de la langue. Comme plusieurs intervenants l’ont mentionné, s’il y a eu amélioration, il ne faut pas voir dans les résultats actuels le signe que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jamais la civilisation occidentale n’a connu un niveau de scolarité aussi élevé qu’au XXe siècle et, pourtant, on estime à environ 30 % le taux d’analphabétisme fonctionnel. C’est dire qu’il faut rester vigilant et continuer à fournir les efforts qui s’imposent. Et si, après le renouveau considérable que la réforme de l’enseignement du français au cégep a traîné dans son sillage (nouveaux cours, plus grand souci de l’expression écrite, efforts concertés, publication de nombreux manuels, de nouveaux classiques québécois…), le taux d’échec était de 40 %, on crierait bien plus justement au sabotage ! Le taux de réussite actuel, un peu moins élevé que le taux de réussite du troisième cours préalable à l’inscription à l’épreuve, montre bien que l’examen de français, dans sa forme présente, n’est pas si loin de la réalité des collèges, contrairement à ce que certains prétendent.

Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications