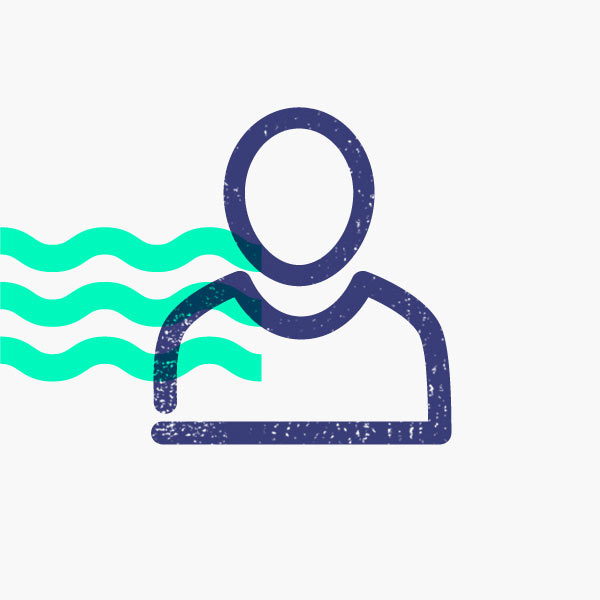Du français tel qu’on le parle ou lorsque l’enseignement de la langue perd le Nord
Depuis maintenant deux décennies que l’approche communicative a pignon sur rue dans le domaine de l’enseignement des langues, la question de savoir « quoi enseigner » ne s’est jamais posée avec autant d’acuité. S’il est normal de procéder constamment à des ajustements lors de l’exécution des programmes de langue, du fait même de la centration sur l’apprenant, il est tout aussi impératif de déterminer, pour une certaine part, le contenu de ces programmes. Néanmoins, tout semble se passer, voire se décider, comme si la langue constituait déjà en soi tout le programme. De ce point de vue, il suffirait de mettre l’apprenant entièrement en face de ce programme, et le tour serait joué.
Dans le présent article, après avoir souligné quelques-uns des problèmes qui se posent si l’on considère ainsi les choses, notamment dans un contexte comme celui du Québec, nous montrerons combien il est illusoire de réduire l’enseignement de la langue à un simple enseignement de « la langue telle qu’on la parle ».
L’enseignement du français
et la francophonie plurielle du Québec
L’enseignement du français au Québec est un défi de taille puisqu’au-delà de toute prescription institutionnelle, l’enseignant doit d’abord répondre à la question « quel français enseigner ? ». Le malaise s’accroît lorsque l’enseignant est francophone d’origine québécoise. En effet, en parlant spontanément avec ses étudiants, par exemple, il désignera toujours les repas en utilisant les mots déjeuner, dîner et souper. Par contre, dans nombre de ses textes pédagogiques, l’étudiant ne rencontrerait que les mots petit déjeuner, déjeuner et dîner. De la même façon, ce professeur aura une tendance naturelle, dans les situations spontanées de communication, à en arracher ou à avoir de la misère à alors que l’étudiant, à travers ses ouvrages, aura plutôt du mal à… En réalité, cet écart entre les habitudes langagières (prononciation, vocabulaire et grammaire) du professeur et les réalités que rencontrent les étudiants dans certains de leurs ouvrages pédagogiques témoignent plutôt de la multiplicité des registres de la langue et n’est pas une particularité du Québec. Au contraire, la nature de toute langue est d’être sujette à variation. De ce point de vue, nous ne devons pas être surpris que, hors de l’Hexagone, le français prenne la couleur locale.
Parlant de couleur locale, il faut souligner l’état de terre d’immigration qu’est le Québec. À ce titre, le Québec accueille d’autres adultes francophones, qui, une fois arrivés, se constituent en microcommunautés regroupant des gens de même origine. C’est ainsi que l’on rencontrera la communauté des Béninois avec leur bonne assise ou leur viens manger, dont les interprétations sémantiques respectives n’auront rien à voir avec le sens des éléments lexicaux en présence. On aura aussi la communauté des Togolais avec leur ton pied mon pied ou tu sors je sors. De la même façon, on rencontrera la communauté des Camerounais avec leur abattoir (maison de passe), celle des Tchadiens avec leur abba-tiré (les économies que font les femmes sur ce que leur donne le mari), de même que celle des Zaïrois avec leur verbe transitif abîmer (rendre enceinte : sans connotation). Les enfants qui appartiennent à ces différentes communautés culturelles fréquentent les mêmes écoles québécoises et y font entendre leur particularismes linguistiques, pourtant de la même francophonie africaine.
Lorsqu’on se trouve en situation d’enseigner le français dans un tel contexte, quel français enseigner ? Doit-on enseigner le français local avec en prime toutes ses variantes internes ou registres ? Ou est-ce le populaire, le courant ou le soutenu qu’il faudrait enseigner ?
Nous voulons faire observer que le fait que la pédagogie des langues vivantes mette actuellement l’accent sur la communication n’arrange pas beaucoup les choses. On a plutôt tendance désormais à confondre tous les registres : régional, familier, oral, écrit, populaire, courant et soutenu. C’est d’ailleurs à cette confusion que nous attribuons la position que défendent de nos jours certains pédagogues ou autres responsables didactiques dont les points de vue comptent, souvent hélas, quant à l’orientation à donner à l’enseignement de la langue.
Les faiseurs de lois ne sont pas
toujours les bons payeurs
Depuis l’avènement de l’approche communicative, des gourous, spécialistes de tels aspects ou de tels autres aspects de la langue, défendent toutes sortes de remèdes miracles pour finir de régler définitivement les problèmes auxquels font face les sujets immédiats (enseignants et apprenants) engagés dans l’apprentissage des langues secondes. Si ces remèdes se veulent originaux et exclusifs pour les maux qu’ils se proposent de guérir, ils sont identiques en un point : l’enseignement d’une langue doit se faire tel que cette langue est parlée. Ainsi, au nom d’une certaine entreprise de promotion du français visant à doter cette langue d’une diffusion mondiale plus grande que celle qui est la sienne, au nom d’un certain souci de ne pas mener contre la langue anglaise, cet envahisseur impénitent, « des combats d’arrière-garde, d’hostilité ou de défensive », on prône l’enseignement, non pas de la qualité, mais plutôt du « français de l’avenir, le français tel que les gens le parlent ». Le grand prétexte qui justifierait la chose, c’est que « la faute d’hier devient la norme d’aujourd’hui. La faute d’aujourd’hui sera la norme de demain ».
Si nous nous permettons de laisser notre coeur s’exprimer, nous dirons combien la vision de l’enseignement des langues des gourous prenant de telles tendances était simpliste. Mais, vous nous répondrez que l’émotion ne doit pas avoir droit de cité dans le débat. Soit !
Il est vrai que le professeur de français, dans sa classe de langue, face à ses étudiants, a besoin de réponses concrètes et pratiques. Entre autres, il voudrait que des réponses lui soient données lorsqu’il demande laquelle de ces paires d’expressions il devrait enseigner. En effet, devrait-il enseigner que « c’est tiguidou » ou au contraire que « c’est super » ? Devrait-il enseigner que « ça a pas d’bon sens » ou plutôt que « c’est incompréhensible » ? Doit-il « être fin en maudit » avec ses étudiants ou plutôt « super sympa » avec eux ?
Remarquons que, ici, nous n’évoquons qu’un aspect du cas où nous nous trouvons au Québec. Dès lors que nous franchissons les frontières de l’Atlantique et que nous enjambons la Méditerranée — disons que nous nous retrouvons du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire — le professeur de français fera face à de nouvelles paires d’expressions telles nouvelles pour « état de santé », sagba pour « frapper, battre », tchatcher pour « bavarder », je vais te mougou pour « je vais te tuer », regardez-moi son bodjo pour « regardez-moi ses fesses ».
Face à une telle disparité des situations de la langue parlée, on comprend aisément que seuls les professeurs de langue ainsi que leurs étudiants fassent les frais de la loi de l’enseignement de la langue orale.
La question à laquelle il faudrait peut-être d’abord répondre est de savoir ce que les apprenants viennent chercher dans nos écoles.
La vie à l’école doit se distinguer
de l’école de la vie
La grande confusion que semble colporter, à tort ou à raison, la position des grands pourfendeurs de l’approche communicative, est de tout confondre et ce, à tous les niveaux. Non seulement on semble considérer la langue comme une unité interne et externe, ce qui est loin de correspondre à la réalité, mais on ne distingue pas non plus entre les univers quant à leur adéquation à telle ou telle autre activité. S’il est une chose que notre état d’immigrant au Québec nous a enseignée par rapport à notre profession, c’est que ce n’est pas à l’école que nous irons apprendre à comprendre une pièce de Michel Tremblay ou une prestation d’Yvon Deschamps. Ce n’est pas non plus à l’école que nous irons apprendre à comprendre une parade humoristique de Patrick Huard, de Daniel Lemire ou d’André-Philippe Gagnon. C’est encore moins à l’école que nous irons apprendre à converser avec le caissier du magasin d’alimentation Métro ou la garagiste qui vient de débarquer de son Shawinigan natal. Toutes ces activités, nous les réussissons au fur et à mesure de notre intégration dans la société québécoise. Nous les réussissons donc grâce à ce que nous appellerons l’école de notre vie au Québec.
Par contre, apprendre à parler français de façon à pouvoir un jour prendre la parole dans l’une des institutions internationales sans que l’on ait besoin de traduire nos propos à d’autres francophones, c’est essentiellement à l’école que nous allons le faire. Voilà justement la différence que nous faisons entre l’école (non institutionnelle) de la vie et la vie dans une école, institution académique. Si l’objectif de la première est d’en arriver à une certaine vulgarisation de la culture, l’objectif de la seconde est de parvenir à une forme élitiste de cette même culture. Sans donc vouloir paraître « vieux jeux », nous percevons la nécessité pour nous, en tant que professeurs de langue, d’enseigner la forme la plus idéaliste possible du français, compte tenu du fait que notre rôle se situe dans le noble univers de la vie à l’école. Nous voulons ainsi distinguer entre l’école de la vie où l’intégration se fait, et la vie de l’école où l’élite se forme. En effet, quand on vient à l’école, l’objectif ultime, même s’il reste inavoué, est de faire la différence. Or nous sommes les agents de cette différence, parce que nous sommes des agents institutionnels. De ce point de vue, ce n’est pas à la norme sociale que nous avons à sacrifier, mais bien plutôt à la norme institutionnelle.
Bref, à notre avis, la seule façon d’éviter une « ghettoïsation » des communautés francophones en fonction des espaces où leurs membres apprennent le français, c’est de transcender cette vision si largement répandue de nos jours qui veut que l’on enseigne simplement le français tel que les gens le parlent. En effet, la centration sur l’apprenant ne doit pas être confondue avec la nécessité de reconnaître que le français, comme toutes les langues naturelles, est une réalité à multiples facettes, tant internes qu’externes. Par conséquent, seule une certaine forme normative de la langue que nous enseignons servira de « lingua franca ».

Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications