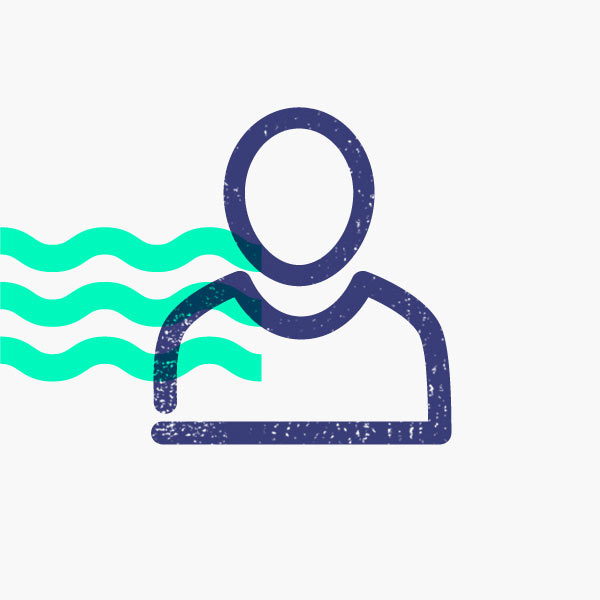L1+L2=?
L’approche communicative : quelques principes
En pédagogie comme dans tout domaine d’activité humaine, les façons de faire changent (évoluent ?). En pédagogie de l’enseignement de l’anglais langue seconde (L2), c’est l’approche communicative qui prévaut présentement, et ce, depuis le début des années 80. Dans l’approche communicative, la parole (talk) est générée par l’élève et non par l’enseignante ou l’enseignant, l’interaction entre les élèves est au coeur de l’expérience d’apprentissage et ce dernier se fait au moyen de tâches (task-based) plutôt que d’instructions portant sur des structures grammaticales précises (discrete point). L’élève « découvre » donc les schèmes grammaticaux de la langue seconde qu’il est prêt à intégrer dans son « interlangage[1] ». Enfin, l’accent est mis sur le sens, le contenu plutôt que sur la forme.
Précisons que — surtout sous l’influence du théoricien américain Stephen Krashen — l’approche communicative distingue nettement entre apprendre (learning) et acquérir (acquisition). Le langage auquel l’élève est exposé (input) diffère (souvent de beaucoup) de ce qui est authentiquement retenu (intake) et désormais disponible pour communiquer dans la langue cible. Au contraire de l’apprentissage, l’acquisition est spontanée, inconsciente, « intuitive » et se produit lorsqu’on met l’accent sur la communication et non sur la forme.
Ainsi, l’on voit déjà que l’un des désavantages de l’approche communicative réside dans le fait que le langage auquel l’élève est exposé n’est pas toujours de haute qualité, puisque, à la suite d’un test de classement administré par l’établissement d’enseignement, les élèves se retrouvent avec des jeunes du même niveau de compétence (interlangage) qu’eux et ayant le plus souvent la même langue maternelle (L1) qu’eux. Les élèves font les mêmes erreurs et ne font pas face à des pannes de communication, puisque l’on accentue la communication, non la forme. Il importe donc de faire prendre conscience aux élèves des sources de leurs erreurs, y compris de l’interférence du français langue première, entre autres par le repérage d’erreurs dites Not English (NE) et Word Order/Syntax (WO). Les premières sont, bien sûr, les faux amis lexicaux, les gallicismes, etc., alors que les secondes sont structurales — l’élève place les mots anglais dans l’ordre syntaxique français, comportement très fréquent dans le placement de l’adverbe et la construction de la question, par exemple. Bien des élèves se rendent compte que cette prise de conscience les a aidés à séparer les deux systèmes grammaticaux en les forçant à mieux les regarder, à voir que l’anglais, malgré ses nombreuses ressemblances avec le français, est bel et bien différent et pas aussi « facile » que ne le veut sa réputation. Comprendre la logique d’une erreur, c’est commencer à pouvoir y remédier.
Lorsque l’accent est mis sur la communication, des facteurs tels que la motivation, le filtre affectif, l’aptitude et la personnalité jouent un grand rôle dans l’acquisition de la langue seconde[2]. Puisque l’approche communicative responsabilise l’élève, elle mise aussi beaucoup sur la maîtrise de la langue maternelle, ici le français (L1), qui devient l’outil principal de la literacy. L’élève de l’anglais langue seconde (L2) qui reçoit peu ou qui ne reçoit pas d’input portant sur la grammaire de l’anglais (la quantité dépend de l’enseignante ou de l’enseignant) peut acquérir sa L2 d’autant mieux que sa L1 est forte. Si, par exemple, je donne des explications ponctuelles sur la formation de la question anglaise, dont la construction est régie par la présence ou l’absence d’un auxiliaire dans la phrase de départ affirmative, la personne qui sait reconnaître le verbe auxiliaire parce qu’elle sait les reconnaître en français possède un avantage. De la même manière, pouvoir déjà reconnaître un adjectif et comprendre sa fonction dans une phrase fera que l’ordre syntaxique — en anglais l’adjectif est préposé au nom — est plus facilement respecté, de même que le fait qu’il soit invariable en anglais. La compréhension du système grammatical favorise un usage correct de l’adjectif, même si l’élève n’en connaît pas le sens exact. Bref, plus les connaissances métalinguistiques sont bonnes, plus l’acquisition de la L2 se fait rapidement.
Effets de la L2 sur la L1
Quand un élève m’informe du fait que son anglais écrit est « bon », ou « pourri », ou que je constate la chose, je profite souvent de l’occasion pour m’enquérir au sujet de son français écrit et, inévitablement, la réponse confirme ce que des recherches ont démontré quant à la relation L1 — L2 : un bon français (L1) écrit est reflété dans un bon anglais (L2) écrit, et l’anglais « pourri » signale une faiblesse en français écrit. « J’ai la même difficulté en français, alors… », me disait un de mes étudiants dernièrement. Alors… quoi ?
Une étudiante exceptionnellement compétente à qui j’ai demandé de réfléchir sur l’effet d’apprendre l’anglais langue seconde sur son français dit avoir constaté que son français oral s’était amélioré après qu’elle eut suivi ses cours d’anglais au collégial. Sa situation est toutefois différente de celle de la majorité des élèves du collégial dans la mesure où, en plus de ses deux cours d’anglais obligatoires, elle a aussi suivi un cours de littérature canadienne-anglaise (de 45 heures) et, surtout, un cours de traduction du français à l’anglais (d’un total de 90 heures, donné dans le cadre du programme Arts et lettres) : « Je pense surtout à ce qu’on a appris en traduction, comme les anglicismes, les faux amis, les expressions idiomatiques, etc. Tout ça m’a permis de mieux posséder mon français et, particulièrement, de pouvoir m’exprimer un peu mieux, en pensant à ce que je dis. Par exemple, je me demande souvent : « Est-ce un anglicisme ? », « Ne devrais-je pas utiliser un meilleur mot que celui-ci ? » » Toutefois, pour ce qui est de son français écrit, « je ne vois pas de quelle façon mes cours d’anglais auraient pu l’influencer », dit-elle. Comme je l’ai mentionné, son niveau de compétence exceptionnel pourrait expliquer ce constat. Maintenant inscrite dans un programme de traduction d’une université francophone de Montréal, elle y a suivi un cours traitant seulement des anglicismes et un autre sur les difficultés du français écrit « dans lequel nous avons vu (ou seulement vu, pour certains) les règles de base de grammaire ». Plusieurs étudiantes, dans ce dernier cours, m’avaient dit craindre les conséquences sur leur français de leur pratique de la traduction vers l’anglais (c’est-à-dire du thème) — celles dont le français est plus faible, sans doute — mais elles se sont vite rendu compte que, au contraire, elles devaient d’abord saisir le sens du texte de départ en français et que cet exercice nécessitait la compréhension des nuances de sens, des temps de verbe ou de la ponctuation de la langue de départ.
Bien que l’anglais soit enseigné comme langue seconde dans le réseau collégial au Québec, pour certains élèves, il s’agit d’une L3. Ainsi en est-il des allophones qui ont le français comme L2, ou des Haïtiennes et Haïtiens qui parlent créole à la maison et français québécois à l’extérieur. Autre découpage possible : pour les élèves venus des régions afin d’étudier à Montréal, l’anglais est souvent plus une langue étrangère qu’une langue seconde, bien qu’elle puisse le devenir grâce à l’exposure en dehors de la classe, dans le véritable laboratoire qu’est la métropole[3]. Cette « exposition » inclut une grande partie de culture anglo-américaine — je pense au rap et à la culture hip-hop, qui influencent fortement le français d’ici et l’anglais aussi, évidemment. Cela se constate tant à l’oral qu’à l’écrit. Une autre influence hors-les-murs est, bien sûr, celle d’Internet — aussi bien la navigation dans le Web que ces chatrooms où les étudiantes et étudiants laissent libre cours au clavardage en anglais sans se censurer sur le plan de la forme. Cette exposition est excellente, mais l’interlangage n’évolue pas nécessairement dans cette situation informelle.
L’effet de l’apprentissage de l’anglais langue seconde sur le français langue première dépend du niveau de compétence dans les deux langues. Ainsi, un étudiant très compétent dans les deux affirme que sa syntaxe est « parfois déformée » : « Je me rends compte que, parfois, au cours d’une discussion en français, j’aurais envie de switcher à l’anglais, étant donné qu’il y a en anglais une expression, un choix de mots ou une façon de le dire qui traduit mieux ma pensée. Et ce n’est pas toujours facile de revenir au français ou d’y trouver un équivalent. » Il a raison d’utiliser le terme switcher, car ce qu’il décrit, le code-switching, constitue un comportement observable chez tous les bilingues, qui se fait de façon volontaire, voulue. Chez une locutrice ou un locuteur moins bilingue, on trouvera plutôt du code-mixing qui, lui, n’est pas conscient et se produit quand la locutrice ou le locuteur ne connaît pas le mot et n’a donc pas le choix. Le premier comportement relève d’une sorte de création alors que le second résulte de la confusion et contamine davantage la langue première.
L’enseignement de la L1, condition d’acquisition de la L2
« Le cégep est un facteur d’anglicisation » (Michel Vastel, SRC, 00.12.18), « C’est au cégep que se fait la majorité des transferts linguistiques, c’est-à-dire que les francophones choisissent d’aller au cégep anglophone » (Jean Charest, SRC, 00.12.12). Voilà ce qu’on peut entendre ou lire dans les médias ces jours-ci. Je ne souhaite pas ici débattre le bien-fondé de ces déclarations, mais plutôt dire que, si tel est le cas, et que, si cet état de fait n’est pas souhaitable en ce qui concerne le maintien du français langue première, il faut chercher des correctifs. Si, comme on l’entend aussi dire, le gouvernement du Québec songe à rendre l’apprentissage de l’anglais langue seconde obligatoire dès la première année, il faudra que les décideurs appuient leurs choix sur des principes pédagogiques solides. Est-ce le cas ? J’avoue craindre que les décisions à cet égard soient basées sur des considérations d’ordre économique — parler l’anglais, mondialisation oblige, n’est-ce pas ? –, ou d’ordre politique — empêchons la désaffection des allophones à l’égard du français en leur enseignant aussi l’anglais à l’école francophone. Soit. Mais qu’en sera-t-il alors de la langue française ? Je crois fermement qu’une langue seconde, qu’une troisième langue ne peuvent être acquises — ce qui n’est pas la même chose qu’enseignées et apprises — si la langue première n’est pas solide. Il y a plusieurs années, des recherches menées auprès d’élèves inuits du Québec de langue maternelle inuktitut, qui éprouvaient de grandes difficultés à apprendre le français ou l’anglais comme langue seconde, ont montré que la stratégie pédagogique à privilégier pour leur permettre d’acquérir plus de compétence communicative n’était pas, comme on l’avait cru, de leur donner encore plus de cours de L2 mais, au contraire, de renforcer la L1. Le progrès de la L1 est donc primordial pour obtenir de bons résultats dans la L2, la L3, etc.
Que le gouvernement et le ministère de l’Éducation souhaitent « installer » l’anglais langue seconde, je ne vais pas m’en plaindre en tant que professeure d’anglais ! Mais, en tant que Montréalaise pure laine et Québécoise de langue maternelle française qui souhaite le maintien du français et, aussi, comme professeure d’anglais qui corrige des rédactions écrites par des étudiantes et étudiants francophones, je m’inquiète des bases pédagogiques sur lesquelles s’appuierait ce changement. Sait-on que pour obtenir de bons résultats en L2 — un « haut niveau d’acquisition », pour employer le vocabulaire de l’approche communicative — on devra s’intéresser très sérieusement à l’enseignement du français et le renforcer au maximum ? L’apprenante ou l’apprenant doit absolument posséder certains concepts cognitifs dans sa L1 pour pouvoir acquérir la L2. S’il est faible dans sa L1, cela favorise un malaise qui pourra créer un filtre affectif quand il s’agira d’apprendre une deuxième langue. Aussi, renforcer la L1 est une affaire de cohérence, car, si l’on veut enseigner la L2 selon l’approche communicative, qui responsabilise les élèves et ne leur enseigne pas la forme, il faut qu’ils puissent aller chercher cela ailleurs, c’est-à-dire dans leur L1 ! Et si celle-ci est faible… on risque de produire l’une de deux situations déplorables, soit du semilingualism, où la personne ne possède ni la L1 ni la L2 correctement, soit un subtractive bilingualism, où la L1 dépérit au profit de la L2 — allant même jusqu’à disparaître parce qu’elle n’a pas reçu l’attention/input/exposure requis. Au contraire, si l’on assure une L1 solide, on crée ainsi une situation, souhaitable, de bilinguisme soit simultané, c’est-à-dire L1 et L2 dès la première année, ou de bilinguisme additif (additive bilingualism) si l’anglais est ajouté plus tard. Le cégep deviendra sans doute un facteur d’anglicisation si les choix en matière d’enseignement de la langue première et de la langue seconde ne se fondent pas sur des principes pédagogiques sains.
On peut se plaindre de l’envahissement culturel de l’anglo-américain, des choix que font les allophones et certains francophones quand il s’agit de leur option linguistique au cégep, invoquer une foule de facteurs autres, mais il faut d’abord prendre conscience de ce que des recherches ont établi quant au rapport L1 et L2 et de ce que des enseignantes et enseignants ont pu observer sur le terrain. En d’autres termes : pour obtenir une langue anglaise ou une autre L2 forte, il est impératif d’avoir un français fort. 
- Le terme « interlangage » décrit la compétence linguistique de transition que développent les élèves en présence d’une interaction ou du input compréhensible (comprehensible input, ou c.i.) en L2. Caractéristique de tout apprentissage de L2, il s’agit d’un processus systématique mais dynamique, qui évolue à mesure que l’élève reçoit du c.i. et revoit ses hypothèses au sujet de la L2. Soumis à des règles précises, l’interlangage peut comporter des caractéristiques de la langue maternelle de l’élève, de la langue cible, et d’autres qui semblent très générales et se retrouvent dans tous ou presque tous les interlangages. Autrement dit, en route vers une pleine compétence dans la langue cible, les élèves doivent acquérir certains sons, mots et structures grammaticales avant que d’autres ne puissent l’être. Curieusement, l’organisation du contenu des manuels d’enseignement de l’anglais langue seconde ne semble pas respecter cet ordre d’apprentissage. Retour
- Encore faut-il bien reconnaître la visée pédagogique : une compétence communicative en L2 (l’habileté d’utiliser la langue dans divers contextes, en prenant en considération la relation entre les locutrices ou locuteurs), le maintien de la L1 ou la maîtrise de la langue seconde ? Évidemment, dans deux cours d’anglais, d’une durée de 45 heures chacun et maintenant obligatoires pour toute cégépienne et tout cégépien, c’est le premier objectif qui est visé. Retour
- N.D.L.R. : La distinction entre « langue étrangère » et « langue seconde » est établie dans « D’un point de vue psychoaffectif, qui est francophone ? », dans ce numéro. Retour
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications