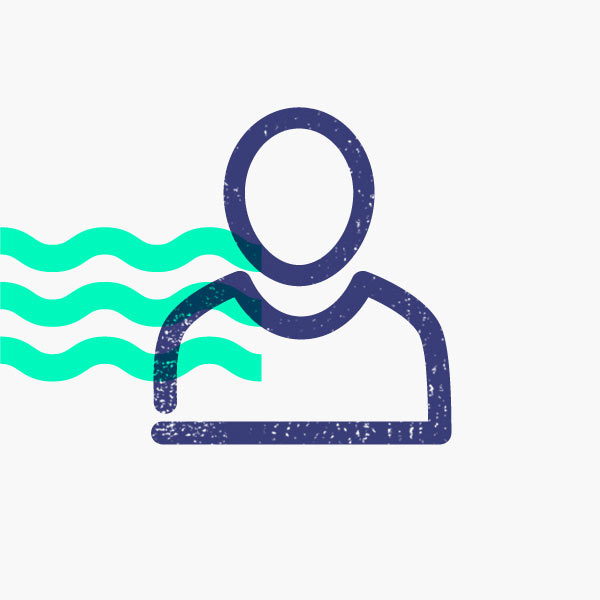Historique de l’orthographe française
Même si la linguistique structuraliste préconise une étude synchronique de la langue, c’est-à-dire faisant abstraction de son évolution à travers le temps pour en faire une description scientifique à un moment précis, l’étude de l’orthographe française ne pourrait être complète sans quelques données historiques essentielles. La complexité et la richesse du français écrit, que certains nommeront parfois, non sans raisons, incohérence, ne peuvent être saisies que par une étude de l’évolution de l’orthographe, ce sur quoi se sont penchés Pierre Burney, Claire Blanche-Benveniste et André Chervel.
Le « malentendu initial »
Pour Pierre Burney[1], le problème orthographique actuel remonte à l’origine même de la transcription du français, alors que l’on adopte l’alphabet latin pour transcrire une langue plus riche en phonèmes[2]. Ce choix est logique puisque, après tout, le français est une forme parlée vulgaire du latin. Cependant, en raison d’une insuffisance de signes, naissent des artifices qu’utilisent les scribes pour pallier le problème, ce qui n’est pas sans créer certaines ambiguïtés encore présentes dans notre orthographe actuelle. Dans Les Serments de Strasbourg (842), l’un des plus vieux textes français connus, on constate que l’auteur utilise le o pour transcrire le e muet, ce dernier n’existant pas en latin. On retrouve ainsi Karlo (Charles) et nostro (notre). Les clercs de cette époque, qui ont appris le latin, tentent alors tant bien que mal d’adapter son alphabet au français.
Les XIe et XIIe siècles voient naître une graphie simplifiée, à cette époque où les jongleurs, qui transcrivent les chansons de gestes, utilisent une orthographe beaucoup plus phonétique. Celle-ci, en revanche, ne consiste qu’en un aide-mémoire par lequel « l’homme de l’art retrouve aisément à la lecture les mots ou les passages qui se sont estompés dans sa mémoire. Que la graphie soit peu adaptée à la phonie, que le système graphique soit lacunaire, cela gêne peu un lecteur qui connaît déjà son texte, et qui tolère une marge de flottement où le même mot écrit peut représenter non seulement plusieurs homonymes, mais aussi des mots de prononciation différente[3] ».
Vers une langue officielle
Une orthographe aussi approximative que celle des jongleurs ne peut subsister au XIIIe siècle, alors que le français devient la langue des textes juridiques et administratifs, lesquels exigent clarté et précision. Le latin occupant encore une place privilégiée chez les élites et au sein de l’Église, on se doit de conserver son orthographe. Ainsi naissent certains procédés de différenciation encore présents aujourd’hui. Un premier étage de 22 lettres (alphabet latin) étant insuffisant, on crée un deuxième étage en combinant les lettres existantes de façon à former des digrammes (ex. : an, in, on, un). Cette solution entraîne des difficultés : comment, par exemple, ne pas lier ai dans ebai ? On a alors recours à l’anticoagulant h muet et on obtient ebahi. De même, le e muet de ennemi permet une prononciation du en différente de celle qu’on retrouve dans le mot ennui.
De plus, des lettres diacritiques[4] viennent s’insérer dans certains mots pour différencier des graphèmes simples qui se confondent. Par exemple, jusqu’au XVIIe siècle, il n’y a pas de différence entre u et v, et le j n’est pas encore utilisé. Au Moyen Âge, la graphie vile valait pour « ville » et « huile ». Le h initial a été ajouté pour donner au graphème v la valeur phonétique ü. Un autre cas d’ajout diacritique est le doublement de certaines consonnes pour marquer que la voyelle précédente est fermée, d’où le double l dans j’appelle, par exemple.
Comme on peut le constater aujourd’hui, bien qu’un bon nombre de diacritiques soient disparus avec l’apparition de nouvelles lettres ou des accents, il en subsiste encore beaucoup. Si, au XIIIe siècle, on a eu besoin d’ajouter un d final à pie (d’après le latin pedem) pour éviter la confusion avec la pie (oiseau), l’apparition de l’accent aigu n’a pas engendré la graphie pié, et ce, pour des raisons idéographiques ; en effet, on avait déjà des mots de même famille, tels pédestre, piédestal, pédale[5].
Fixation de l’orthographe
C’est à partir du XVIIIe siècle que se fixe l’orthographe telle qu’on la connaît de nos jours. Depuis l’invention de l’imprimerie à la fin du XVe siècle, étymologistes et traditionalistes s’opposent. Dans la troisième édition du dictionnaire de l’Académie française (1740), on voit disparaître de nombreuses consonnes inutiles grâce à l’emploi des accents aigus, graves et circonflexes (ex. : fête pour feste). L’apparition des dictionnaires, malgré les contradictions d’une édition à une autre, coïncide avec la naissance d’une norme orthographique.
Idéographique ou phonétique
Burney, dressant l’état présent de notre orthographe, souligne son aspect « intellectuel » et dégage ses caractéristiques essentielles. D’abord, elle est étymologique en ce qu’elle conserve les traces de ses origines latines et grecques. Elle est aussi grammaticale, car elle indique les rapports existant entre les éléments d’une même phrase (ex. : accords au féminin et au pluriel). Enfin, elle différencie les homonymes grâce à son aspect idéographique. « Cela, dit-il, lui donne un certain caractère esthétique, puisque les mots ne sont pas seulement le calque du son, mais présentent une sorte de physionomie graphique où les lettres superflues font figure de « signes particuliers » ou d’ornements[6] ». On pourrait dire de l’orthographe française qu’elle est un compromis entre une transcription purement phonétique et une représentation idéographique. Ce caractère idéographique semble être la principale source de difficulté de l’écriture du français. Le mot oiseau en est un des meilleurs exemples : ses graphèmes[7] sont très éloignés de la transcription en A.P.I.[8] [wazo]. René Thimonnier[9] vise juste lorsqu’il affirme que l’orthographe française, par son caractère idéographique, facilite la lecture au détriment de l’écriture.
À la lumière de ces quelques données historiques, il est facile de comprendre le pourquoi et le comment d’une complexité orthographique qui, si on constate l’échec des tentatives de réforme, semble aujourd’hui presque irréversible. Aux partisans d’une orthographe plus phonétique s’opposeront toujours ceux d’un courant plus traditionaliste, conscients de la richesse étymologique du français écrit.

- BURNEY, Pierre, L’Orthographe, Paris, Presses universitaires de France, 1970, coll. « Que sais-je ? ». Retour
- Le phonème est l’unité sonore minimale produite par les organes de la parole et ayant une valeur distinctive et différenciative. Retour
- BLANCHE-BENVENISTE, Claire et André CHERVEL, L’Orthographe, Paris, Librairie François Maspero, 1969, p. 72. Retour
- Qui servent à distinguer, à caractériser. Retour
- BLANCHE-BENVENISTE ET CHERVEL, op. cit., p. 75. Retour
- BURNEY, Pierre, op. cit., p. 32. Retour
- Unité distinctive de l’écriture. Retour
- Alphabet phonétique international. Retour
- THIMONNIER, René, Pour une pédagogie raisonnée de l’orthographe, Paris, Hatier, 1974. Retour
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications