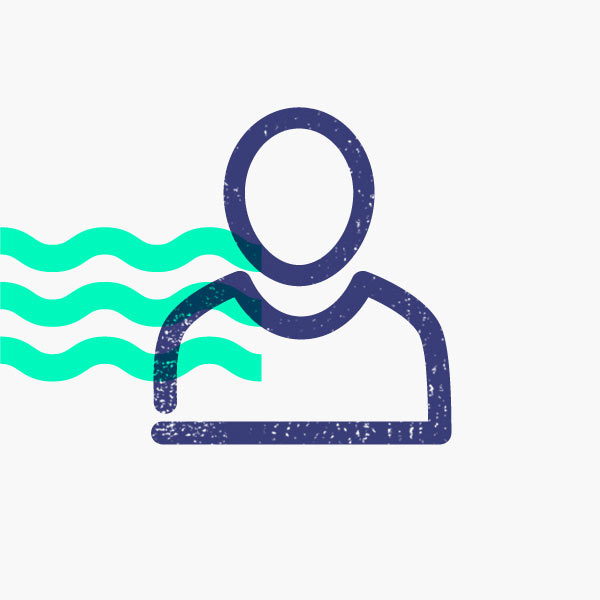La maîtrise langagière à l’entrée des études supérieures: mythes, constats et essais d’intervention
Autre pays… mêmes problèmes. À l’Université de Namur, les professeurs Monballin et Legros ont soumis des étudiants du premier cycle universitaire à un test par QCM (questions à choix multiples) et à une production écrite. Les résultats révèlent des similitudes étonnantes — et rassurantes ?– entre les problèmes éprouvés par ces étudiants et les difficultés de nos cégépiens.
À un moment où s’affirme la nécessité d’évaluer le plus fidèlement possible la compétence linguistique et langagière des élèves qui atteignent le collégial, et que de nombreuses questions se posent sur le choix des moyens les plus efficaces pour y parvenir, cet article offre une réflexion stimulante sur les objectifs, la composition, l’interprétation et l’utilisation des tests.
« Ils ne connaissent plus le français » : c’est ce que répètent à l’envi, en Belgique comme ailleurs dans la francophonie, depuis quelques années, les maîtres de différentes disciplines et les médias à propos des jeunes qui entament des études supérieures. Fréquemment en possession d’écrits ou d’exposés présentant, effectivement, des défauts linguistiques, nous avons, nous aussi, comme enseignants de premier cycle universitaire dans une faculté de philosophie et lettres, plus d’une fois déploré cette situation.
Mais en rester à la plainte (qui ne date pas d’aujourd’hui !) n’est guère productif. Aussi avons-nous tenté de la dépasser en explorant des façons d’informer les étudiants débutants sur leurs carences éventuelles tout autant que sur certaines particularités de la communication « scientifique » en vigueur à l’université, et de leur offrir des possibilités de s’améliorer et de s’adapter à de nouvelles exigences.
Pour aider les étudiants, nous avons mis au point deux épreuves diagnostiques auxquelles on les soumet en tout début d’année : un test, sous forme de QCM, de lexique et de raisonnement logique, et une production écrite. La première vise essentiellement à leur faire prendre conscience de leur degré de maîtrise langagière, la seconde ouvre en outre à des possibilités de remédiation.
Le test par QCM
Ce test ne couvre pas tous les aspects de la langue : l’orthographe et la syntaxe, par exemple, sont évaluées dans la production écrite. Ce n’est pas faute d’instruments adéquats : des QCM, adaptés au niveau des étudiants débutants, ont été utilisés ailleurs[1]. Mais cette forme de test, certes commode, a comme désavantage de placer le scripteur dans une situation assez artificielle, et nous avons pu constater à plus d’une reprise, avec un groupe plus restreint[2], que les résultats obtenus à des QCM dans ces deux domaines semblaient majorer la compétence effective : la plupart des étudiants réussissent assez bien ces épreuves formelles, ce qui ne les empêche pas, en production, de commettre bon nombre d’erreurs et de maladresses.
Nous avons plutôt axé notre test sur le vocabulaire (60 questions sur 77), lequel ne se mesure pas suffisamment en production écrite, où existe toujours la possibilité d’éviter l’emploi d’un mot mal connu. En outre, certaines confusions lexicales (dues, par exemple, à la paronymie) et, plus largement, l’ignorance d’un certain vocabulaire abstrait, d’une certaine « langue intellectuelle » ont une forte incidence sur la réception par les étudiants des discours écrits et oraux. Une toute récente mesure à l’entrée de la 5e année du secondaire vient encore de montrer des corrélations assez fortes entre un tel test de vocabulaire et les performances en lecture des élèves[3]. Nous avons également établi des corrélations ; encore à l’étude (elles ne représentent pas le but principal de notre travail), elles illustrent une assez bonne convergence entre les résultats obtenus à notre test d’entrée et ceux de fin d’année universitaire, ce qui tend à confirmer l’intuition de départ.
La prudence reste néanmoins de rigueur : avant d’en inférer une quelconque valeur prédictive, il faut rappeler fermement à quel point la mesure est délicate. Sans parler du moment où elle s’effectue ou de la manière de tester, une bonne partie de la difficulté tient au manque de critères pour définir ce qu’est un « vocabulaire abstrait de base » et au fait qu’intervient, plus que dans d’autres domaines de la langue, une part d’aléatoire dans la connaissance d’un mot. Le savoir est ici moins « construit » qu’ailleurs ; ainsi un étudiant peut très bien maîtriser d’autres mots de difficulté équivalente à ceux qui lui sont proposés et sur lesquels il achoppe.
Pour limiter les biais, nous avons établi la liste de nos items à partir de relevés d’erreurs récurrentes dans les copies et d’une estimation de la fréquence d’usage de certains termes dans plusieurs cours. Nous avons par ailleurs opté pour une diversification des entrées : mot testé en contexte ou isolé, modes de reconnaissance variés (reconnaissance d’un synonyme dans une liste de quatre items, d’une synonymie ou d’une antonymie dans une liste de quatre reformulations de la phrase ; corrélation à une définition ou à cinq autres mots, en indiquant le rapport de sens : identité, contrariété ou absence de rapport).
L’autre partie du test, plus limitée (17 questions), porte sur le raisonnement logique. On propose des suites de phrases, des déductions ou des paraphrases, entre lesquelles il faut choisir. C’est la capacité d’inférer et de percevoir les relations logiques implicites que l’on essaie d’atteindre ici ; de nombreuses études en ont montré l’incidence dans le processus de compréhension à la lecture[4]. Chaque fois, on observe que cette partie du test est mieux réussie que l’autre : globalement, sur trois années[5], la moyenne obtenue est de 11,4/20, contre 9,5/20 pour la partie consacrée au vocabulaire.
Faut-il s’inquiéter de la faiblesse de cette dernière moyenne ? Du fait que plus de 50 p. 100 des étudiants ne maîtrisent pas la signification de mots comme affranchir, allégation, anticiper, assujettir, carence, clivage, dénégation, éclectisme, éludé, émanciper, empirique, entériner, exhaustif, exhorter, expédient, hypertrophié, inhérent, injonction, intempestif, intrinsèque, partial, précarité, présomption ; plus de 70 p. 100, celle de à l’instar de, corollaire, dissidence, inférer, latent, patent, prérogatives, probité, réactionnaire, stigmatiser, subversion, virtuel ?
Sans doute, ce vocabulaire est-il assez rare dans la communication courante, où l’ignorer n’est donc pas préjudiciable ; mais il devient fréquent dans les études supérieures, où il ne sera cependant jamais enseigné comme tel, contrairement aux métalangages propres aux disciplines. N’en être pas familier risque dès lors d’y être lourd de conséquences, car ce n’est pas seulement la production qui est en jeu, mais la réception même des enseignements (et aussi des consignes, des questions…), dès lors ouverte aux malentendus et contresens.
En communiquant aux étudiants leurs résultats individuels[6] à cette épreuve, nous cherchons surtout à provoquer une prise de conscience de cette réalité. En effet, comme nous l’avons dit plus haut, la mesure est délicate et nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, de critères qui permettraient de fixer des seuils de réussite. En outre, la remédiation dans ce domaine est particulièrement difficile : que sait-on des mots « nécessaires » pour garantir de meilleures performances ? et des acquisitions par imprégnation en cours d’année ? Quelles méthodes utiliser pour éviter de reproduire les modes d’apprentissage qui, en la matière, n’ont pas fait leurs preuves dans le secondaire ?
La production écrite
Parallèlement au test, les étudiants sont invités à rédiger un texte d’une quarantaine de lignes (300 à 350 mots) sur un sujet conçu de façon à réduire les écueils liés à la recherche des idées, puisque le but n’est pas de juger cette composante de la production[7]. Nous y évaluons en effet, d’une part, l’orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation, la mise en paragraphes et, d’autre part, la construction textuelle et l’adéquation de la structure argumentative aux points à traiter dans le sujet.
Une grille de correction critériée[8], avec une échelle de points par rubrique, a été élaborée, de manière non seulement à homogénéiser les corrections, mais surtout à pouvoir déterminer avec plus de précision les aspects les moins bien maîtrisés et dès lors mieux cibler les remédiations. Par exemple, pour la rubrique « construction textuelle », sont évaluées la cohérence et la présence de marques de progression (connecteurs, substituts lexicaux, anaphores…) ainsi que d’une conclusion.
En général, on constate que la partie discursive obtient une moyenne un peu plus élevée (11,2/20) que la partie « langue » (10,8/20). Dans environ 20 p. 100 des copies, on peut estimer qu’il y a une bonne réalisation des critères textuels. Quelque 60 p. 100 présentent certains défauts de construction (ratés dans certaines connexions, progression peu « orientée »), mais pas au point d’invalider la cohérence d’ensemble et la saisie du propos. Il reste un peu plus de 20 p. 100 de l’ensemble qui comportent d’importants défauts de structure : pure juxtaposition d’idées, contradictions internes ou coq-à-l’âne, « désordre » (sauts logiques, retours injustifiés), auxquels s’ajoute parfois un usage anarchique des connecteurs.
Du côté de la langue, la moyenne du nombre de fautes par grandes rubriques s’établit comme suit : 6,2 pour l’orthographe, 2,4 pour la syntaxe et 1,5 pour le vocabulaire. Pour la ponctuation, on peut estimer que dans 30 p. 100 des copies, on en fait un usage varié et on emploie les signes à bon escient ; 45 p. 100 n’en font qu’un usage pauvre, limité aux points et aux virgules ; 25 p. 100 ajoutent à cette pauvreté des erreurs diverses.
Faut-il considérer ces scores comme alarmants ? Faute de résultats comparables d’années antérieures, il est délicat de les interpréter comme indicatifs d’une baisse de niveau dans la maîtrise de la norme. Au-delà des chiffres, ce sont peut-être les types de fautes qu’il est intéressant d’envisager, puisqu’ils fournissent des indications sur les aspects qui font problème et qui devraient faire l’objet d’un nouvel enseignement.
En orthographe, c’est la catégorie des erreurs grammaticales qui est la plus fournie (environ 60 p. 100) et les problèmes d’accord en représentent une bonne partie. La difficulté apparaît surtout lorsque le « receveur » (mot à accorder) précède le « donneur » (mot qui commande l’accord) ou lorsque, dans l’ordre de succession normal, des écrans s’interposent entre les deux : tout se passe comme si la linéarité de la phrase prenait le pas sur sa structure, et la mémoire, sur l’analyse. Mais il y va aussi d’une indifférence générale aux contraintes formelles de l’écrit, au bénéfice du seul sens à exprimer : ainsi, outre les erreurs classiques (sujet-verbe, substantif-adjectif, participe), on rencontre assez souvent des inadéquations dans les reprises d’un référent par un possessif ou un réfléchi (Ces repères nous permettront de s’orienter…).
On relève également des méconnaissances des formes de la conjugaison : confusions courantes entre les flexions du futur et du conditionnel, ou entre celles du participe et du passé simple (il eu, il a vécut, on a permit), mais aussi tendance à assimiler les verbes en —ir et —oir aux verbes en —er (il recueilla, il deva)… Et, enfin, des hésitations se manifestent quant au nombre de certains mots invariables comme aucun, chaque, chacun, souvent enrichis d’un –s.
Pour l’orthographe lexicale, outre une insouciance fréquente par rapport aux accents et le problème bien connu des géminées, on constate l’ignorance de certaines régularités dans les terminaisons de mots et dans les mécanismes de suffixation, ce qui entraîne une incapacité à prédire les formes les plus probables ou la production de formes aberrantes (le consula, embarquation…).
En syntaxe, on rencontre assez souvent des erreurs de construction liées à l’utilisation de dont, en et y, et surtout dans l’usage des prépositions (choix inadéquat ; coordination abusive de verbes à rections différentes : Au niveau politique, qui répercutera et répondra aux questions des jeunes ?). En outre, la gestion des modes indicatif/ subjonctif n’apparaît pas toujours très sûre, tout comme celle de l’interrogation indirecte — que bien des scripteurs, sous l’influence d’un usage qui se répand à l’oral, construisent comme une interrogation directe (On se demande que fait-il ? ou On se demande qu’est-ce qu’il fait ?). Enfin, bien des phrases complexes apparaissent maladroites jusqu’à ambiguïser le propos.
Remédiation
C’est précisément aux ambiguïtés créées dans la communication par ces erreurs ou inadéquations que nous tentons de rendre sensibles les étudiants qui, sur la base des résultats de la production écrite, demandent une aide. Plus qu’à la norme en soi, c’est donc à un objectif communicationnel que nous lions la plupart des rappels normatifs et l’analyse de certains aspects de la discursivité.
Ces rappels interviennent à l’occasion d’exercices d’écriture et de réécriture, au cours desquels les apprenants sont invités à utiliser des grilles d’autocorrection pour l’orthographe et la syntaxe. C’est là un bon moyen d’amorcer une stratégie d’amélioration individualisée, sachant que, souvent, chacun a son propre système d’erreurs, répétitif et assez limité, qu’il convient de mettre à jour et d’analyser. Du côté de la discursivité, c’est principalement sur la variété des ressources linguistiques pour marquer la progression textuelle (dont la découpe en paragraphes) que l’accent est mis.
Au-delà de cet investissement en « perfectionnement de l’écrit », compréhensible dans une faculté de philosophie et lettres, le dispositif de remédiation comprend également (toujours pour les étudiants demandeurs, après les premiers travaux ou interrogations dans leurs disciplines) un module intitulé « Adéquation de la réponse à la question ». Il s’agit d’une tentative de réponse au constat de bon nombre d’enseignants qui attribuent, totalement ou partiellement, la contre-performance de l’étudiant interrogé à une mauvaise lecture de l’énoncé ou à une réponse inadéquate aux attendus de la question.
Sur la base de questions et de réponses réelles, on tente d’y développer une attitude de prise de distance par l’analyse. On y apprend notamment à discriminer les données et les consignes, pour contrer la tendance spontanée à lire de façon atomisée (l’étudiant se précipite sur un mot de l’énoncé qui renvoie à l’objet visé par la question et dit tout ce qu’il sait de ce dernier, sans trop se préoccuper de ce qu’on lui demande de faire à son propos). Des exercices de reformulation, la construction d’une typologie des questions, l’évaluation de réponses sélectionnées pour leur exemplarité (tant dans les défauts que dans les qualités) débouchent sur des essais de construction de schémas de réponses, dont l’adéquation est mise à l’épreuve par circulation des copies et négociation dans le groupe[9].
Pour élargir la réflexion
Les insuffisances proprement linguistiques sont donc bien réelles, et des actions palliatives nécessaires. Cependant, comme l’indique la dernière activité citée, il nous paraît que d’éventuels succès d’intervention sur des aspects strictement langagiers ne suffisent pas à résoudre d’autres dysfonctionnements, plus fondamentaux à nos yeux, dans le processus de l’échec en première année d’études supérieures, et dont se plaignent les collègues d’autres facultés.
Regroupant des enseignants spécialistes de la langue et des pédagogues, une recherche interdisciplinaire que nous menons depuis deux ans, pour analyser les relations entre une maîtrise langagière insuffisante et l’échec, fait clairement apparaître l’interaction d’autres facteurs. Des facteurs cognitifs comme la capacité de conceptualisation et les mécanismes de traitement de l’information entrent évidemment en jeu ; tout un travail est à entreprendre, de ce côté, sur les stratégies de résolution de problèmes, qui varient selon les disciplines et dépassent la question de l’expression linguistique du résultat. Mais il faut s’interroger en outre sur la clarté du « contrat didactique », ce qui n’implique pas que l’étudiant. Ainsi, il reviendrait à l’enseignant d’expliciter les règles, souvent tacites, qui touchent la communication, par exemple dans le cas d’une épreuve orale, où les attentes et les représentations de l’interrogateur et de l’étudiant sont loin d’être identiques : le premier attend souvent, sans le dire, un exposé construit, complet, compréhensible par quelqu’un qui ne connaîtrait pas la réponse a priori, conforme à certaines normes « scientifiques »…, alors que le second, rivé à l’urgence de montrer qu’il a étudié et qu’il sait, compte sur la coopération d’un interlocuteur mieux informé pour combler les lacunes de ce qu’il dit.
À ces dimensions cognitives et didactiques doivent encore s’ajouter des facteurs épistémiques : des représentations inadéquates du savoir ou des langages scientifique et disciplinaire jouent en effet un grand rôle dans le processus d’échec. Si, par exemple, comme certains le déclarent parfois naïvement, un étudiant reste persuadé que scientificité rime avec obscurité, on voit mal comment il pourra adopter les bonnes stratégies pour affronter ce qui résiste à son appréhension spontanée ou pour s’exprimer lui-même avec rigueur et clarté ; s’il considère le savoir comme un produit fini, sûr, comment pourra-t-il entrer dans la démarche d’appropriation critique à laquelle l’invite l’université ? Ces représentations « spontanées » de la science — ou de la discipline particulière, ou du rôle qu’on est appelé à y tenir — qui font si souvent écran pour les débutants, nous avons aussi fait quelques tentatives pour les expliciter et pour les déplacer, de façon à permettre à un plus grand nombre d’étudiants de s’adapter à une nouvelle « culture », de se forger progressivement une nouvelle identité (au moins intellectuelle) ; mais c’est là une autre histoire, à partager ultérieurement, peut-être…

- À l’Université de Liège, entre autres. Une analyse de l’évaluation permise par ces QCM et d’autres contributions sur le thème qui nous occupe ont fait l’objet de deux journées d’étude, à l’ULG, en mai 1999. Voir : DEFAYS, Jean-Marc, Marielle MARECHAL et Solange MELON, éd., La maîtrise du français. Du niveau secondaire au niveau supérieur, Bruxelles, De Boeck Université 2000 (Pratiques pédagogiques). Retour
- En l’occurrence, une centaine d’étudiants de la section « Langues et littératures romanes » (ces études formant les futurs maîtres de français du secondaire supérieur). Retour
- Mesure commanditée par le Ministère. L’analyse des résultats aux épreuves de lecture et d’écriture est en cours. Retour
- Voir notamment LAFONTAINE, Dominique, Performances en lecture et contexte éducatif, Bruxelles, De Boeck Université, 1996 (Pédagogies en développement). Retour
- Cela représente près d’un millier d’étudiants testés, dans deux facultés : Lettres et Médecine. Retour
- La performance individuelle peut être comparée aux moyennes obtenues par la section d’études et par l’ensemble de la population testée. Sont également signalés les pourcentages d’étudiants dans des « fourchettes » de résultats (entre 0 et 5, etc.), par rapport auxquels chacun peut se situer. Retour
- Exemple : « Une personne de votre entourage s’étonne de vous voir entreprendre, à l’époque de la technologie et de l’économie triomphantes, des études de philosophie et lettres. Essayez de la convaincre de l’intérêt de votre choix aujourd’hui. » Retour
- Notre grille est largement inspirée de celle de la recherche DIEPE, à laquelle nous avions participé. Groupe DIEPE, Savoir écrire au secondaire. Étude comparative auprès de quatre populations francophones d’Europe et d’Amérique, Bruxelles, De Boeck Université, 1995 (Pédagogies en développement). Retour
- Voir LEGROS, Georges, « Savoir et savoir-dire : définitions et réponses vides », Enjeux, Namur, CEDOCEF, no 21 (« À l’Université aussi… »), 1990, p. 90-99. Retour
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications