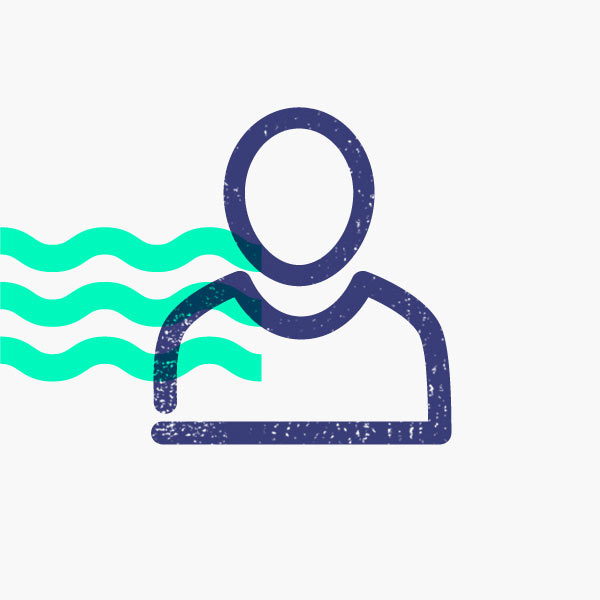Ne tirez pas sur l’ambulance!
Les centres d’aide en français demandent des comptes
En plaçant les centres d’aide sous l’éclairage cru des chiffres, l’article de Louis Lafrance, dans Le Devoir du 14 février, offrait une occasion de réagir aux dramatiques incohérences du système d’éducation et de la société québécoise vis-à-vis de « sa » langue. Encore faudrait-il que les chiffres ne soient pas assujettis à la langue de bois des fonctionnaires.
D’entrée de jeu, soulignons que nous rêvons volontiers du moment où « la majorité des Québécois » pourront « dépasser le lien technique et utilitaire qu’ils entretiennent avec leur langue maternelle ». Dans ce sens, le témoignage de cet étudiant qui s’est découvert « la passion du mot juste » conforte les professeurs qui, depuis dix ans, oeuvrent dans les CAF : leurs efforts portent fruits ! En fait, pour qui fréquente ces centres, point n’est besoin de justifications tant sont quotidiennes de telles manifestations.
Avant, cependant, de rêver de dépassement, encore faudrait-il que soit assurée une maîtrise fonctionnelle de la langue qui permette aux jeunes Québécois de poursuivre des études collégiales. Telle était l’humble mission que s’étaient donnée les professeurs de français lorsqu’il ont fondé les centre d’aide en français, il y a dix ans et plus (Le Devoir, 17 octobre 1988). À ce propos, il n’est pas inutile de relever que cette initiative est née non pas du Ministère mais du milieu collégial ému par l’incapacité de jeunes cégépiens à formuler leur pensée, et à faire les apprentissages disciplinaires requis faute d’une maîtrise suffisante de la langue.
En 1988, le Ministère a appuyé financièrement cette prise en compte d’une responsabilité sociale et éducative. Sa contribution de trois millions par année semble trop lourde ? Que dit-on alors des 10 milliards $ que coûterait chaque année l’analphabétisme fonctionnel au Canada (Rapport Paul Jones, Canadian business task force on literacy, Toronto 1988) ? Que dit-on, par ailleurs, des économies réalisées depuis 1959 alors qu’on a réduit de 25 % l’enseignement du français au secondaire ? Combien coûte, chaque année, le travail d’évaluation des centres d’aide ? S’il est tout à l’honneur du ministère de l’Éducation de veiller à la rentabilité de ses placements, encore faudrait-il qu’il parte de « toutes » les données.
Il serait honnête aussi que la méthodologie utilisée ne compare pas « des pommes et des oranges » comme le mentionne l’article. Qu’on en juge par l’évocation d’un exemple : seuls les élèves qui accèdent à l’université sont comptabilisés dans l’étude de Aubin. Or, en grande part, les centres d’aide consacrent leurs ressources aux élèves du secteur professionnel et aux allophones qui ne sont pas, eux, comptabilisés. Par ailleurs, grâce au cours dispensé aux moniteurs, ce sont maintenant presque 15 000 jeunes qui ont développé une conscience linguistique active et constituent, pour leur milieu, des agents motivateurs. Plusieurs, du reste, se sont dirigés vers l’enseignement. Ceux-là, par contre, ne sont pas comptabilisés. Voilà pour le quantifiable.
Il faut savoir, par ailleurs, qu’un autre aspect de la contribution de centres d’aide n’est pas de l’ordre du quantifiable mais du qualitatif. En effet, le développement d’une approche pédagogique misant sur la relation d’aide par les pairs est mobilisateur et socialement rentable, surtout lorsqu’il s’agit de la langue. Plus que toute autre, cette discipline fondamentale est conditionnée par le rapport affectif et, en ce sens, l’esprit de collaboration créé par les moniteurs a réconcilié bien des jeunes au bord du décrochage avec la langue, avec eux-mêmes et avec les études, pas nécessairement avec les participes passés et les anglicismes que la très grande majorité des adultes ne maîtrisent pas de toute façon. Les 3 millions $ du Ministère seraient-ils mieux placés pour payer les factures du décrochage ?
Il serait temps, en effet, de cesser de gaspiller l’argent des contribuables et l’énergie des gens de terrain ; il serait surtout temps d’avoir une véritable politique pédagogique et sociale en matière d’enseignement de la langue.
Oui, il est aberrant que des élèves arrivent si démunis au collégial qu’on ne peut se résoudre à les abandonner à l’échec ! C’est une question d’éthique professionnelle et, au nom de cette éthique, nous demandons des comptes :
- au ministère de l’Éducation qui, contre tout bon sens, a commencé une réforme par le collégial au lieu de mettre en place une formation langagière progressive, structurée et attestée par une évaluation effective, notamment de la langue écrite ;
- au ministère de l’Éducation encore, et au ministère de la Culture qui, contrairement à tous les pays qui se respectent, ne coordonnent pas leurs efforts pour rendre l’enseignement de la littérature obligatoire au secondaire. Une langue s’apprend d’abord dans la dynamique de la parole et par l’immersion, dans les bons textes de préférence. Priver les jeunes Québécois de la littérature c’est les priver d’une source essentielle de motivation à l’apprentissage de la langue : le rapport émotif aux autres et à soi-même. L’enseignement de la langue doit se faire en contexte et la littérature est l’un des contextes les plus riches et les plus stimulants (un beau sujet de réflexion pour les états généraux sur l’Éducation !) ;
- aux professeurs de toutes les disciplines et de tous les niveaux qui ont la responsabilité de veiller à ce que les jeunes utilisent une langue de qualité et de contribuer au développement de la compétence des élèves par l’exploitation systématique de la lecture et de l’écriture. « C’est en forgeant qu’on devient forgeron », faut-il le rappeler ? Question de cohérence pédagogique aussi, la langue est l’outil de pensée ; former les élèves, c’est leur en donner les moyens, qu’elle que soit la discipline que l’on enseigne ;
- aux médias et à la société québécoise qui ne mettent pas tout en oeuvre pour s’assurer que les jeunes évoluent dans un milieu où la qualité de la langue est une préoccupation constante et qui ne rendent pas suffisamment explicite le message que la maîtrise de la langue est une valeur individuelle et collective.
La qualité de la langue est une responsabilité collective et les lacunes des jeunes nous renvoient à notre laxisme, à notre indifférence, voire à notre incompétence. Faut-il ajouter la mesquinerie ?
Les centre d’aide en français renvoient la balle dans le camp où elle devrait être et demandent, en effet, des comptes à tous ceux qui ne s’attaquent pas au problème de fond mais aux mesures d’urgence qui visent à aider les plus démunis et qui ont réussi néanmoins, à force de conviction, à animer leur milieu et à sensibiliser ne serait-ce qu’à la « passion du mot juste ».

Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications