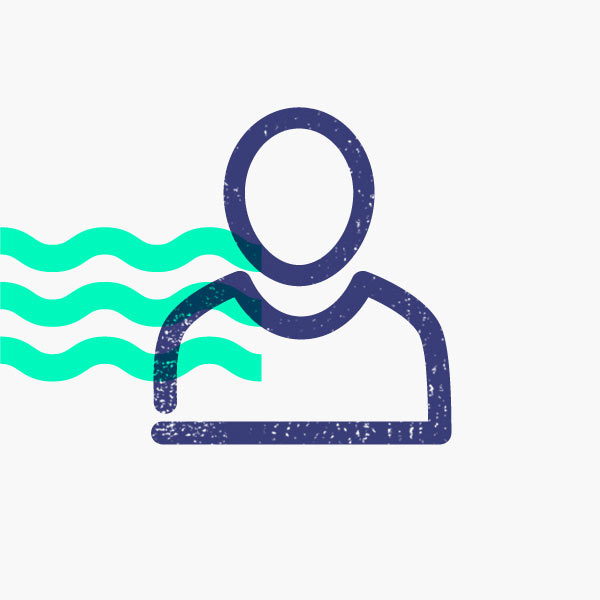Pour le meilleur et pour le pire
Observée avec la lunette de l’évaluateur, l’évolution de l’épreuve uniforme de français présente un intérêt particulier du fait qu’elle constitue la démonstration éloquente des effets que peut exercer la mise en place de mécanismes d’évaluation sur l’écologie d’un système scolaire. Cet intérêt est relié à l’émergence, dans le domaine de l’évaluation des apprentissages, d’une vision élargie de la validité où l’on prend en considération non seulement le contenu d’une épreuve, mais aussi les conséquences de son utilisation (Messick, 1989 ; Fredericksen et Collins, 1989 ; Moss 1998 ; Shepard, 1998). Dans les lignes qui suivent, nous essayerons de montrer de quelle manière se sont manifestés les effets de l’instauration du test de français, à l’échelle provinciale, à la sortie du collégial. Nous pourrons alors esquisser les grandes lignes de ce qui devrait se faire pour encore mieux apprécier l’effet des épreuves uniformes.
Un éveil à l’importance de bien écrire
À l’origine, l’alarme avait été sonnée par les universités, qui avaient décidé de mettre en place des tests de français écrit en vue de l’admission dans certains programmes. Il est ensuite apparu qu’il était du ressort des cégeps de procéder à cette évaluation dans la mesure où l’ordre collégial pouvait être considéré responsable de la consolidation des acquis en langue maternelle. L’instauration d’épreuves uniformes dont la réussite est une condition à l’obtention du diplôme est venue confirmer l’engagement des collèges à assurer la maîtrise de la langue écrite. Cette prise en charge s’inscrivait dans ce qui est devenu alors un enjeu majeur en éducation, voire un débat de société.
Pour plusieurs, il fallait réagir face à la piètre qualité du français écrit des collégiens, elle-même perçue comme le produit d’une forme de négligence de la part du système éducatif. Il était alors devenu évident que la compétence à rédiger dans la langue d’enseignement faisait partie des compétences à développer non seulement pour poursuivre des études, mais également pour occuper les postes auxquels peut conduire une formation collégiale et même prétendre à une certaine promotion sociale. Instaurer une épreuve revenait à consacrer l’importance de bien écrire dans l’échelle des valeurs de la société québécoise et à reconnaître le caractère transversal des compétences en jeu par rapport à des compétences disciplinaires ou spécialisées. Dans cette perspective, ce n’était plus que les professeurs de français qui étaient interpellés mais tous les intervenants de l’ordre collégial. Qui plus est, la sensibilité générale des citoyens pour les questions de langue a donné à la maîtrise du français écrit la dimension d’une priorité sociale.
Une vision de la maîtrise de la langue écrite
À la différence de plusieurs comportements sociaux où l’on détermine avec une relative aisance ce qui est socialement acceptable et ce qui ne l’est pas, l’expression écrite se base sur un ensemble de règles dont on sait qu’elles ne suffisent pas à décrire la compétence en jeu. Une épreuve cohérente s’appuie sur une conception des habiletés et des attitudes qui contribuent à sa réussite. C’est cette combinaison d’habiletés et d’attitudes que les docimologues nomment un « construit ». La validité de l’épreuve est reliée à la possibilité d’inférer la présence des éléments qui composent le construit, à partir de la performance observée.
Le construit des premières épreuves du secondaire reposait sur la double articulation discours/langue. Cette double articulation a été maintenue au collégial malgré l’introduction, dans les épreuves uniformes, d’éléments de contenu faisant notamment intervenir les connaissances littéraires. L’évaluation des habiletés reliées au discours et au contenu s’effectue à l’aide de critères qui font directement appel au jugement de l’observateur. Par contre, l’évaluation des habiletés reliées à la langue demande une comptabilisation du nombre d’erreurs. Cette vision se défend, mais on peut se demander si l’illusion d’objectivité que confère la comptabilisation ne renforce pas l’idée d’une compétence à écrire qui se définit surtout par la capacité à utiliser correctement le code grammatical. Les premières versions de l’épreuve, celles qui s’adressaient aux étudiants se destinant à des études universitaires, ont renforcé cette vision réductionniste centrée sur le code grammatical. En effet, le plafonnement de l’évaluation des habiletés reliées au discours, combiné à l’adoption d’un double seuil de passage pour la langue, contribuaient à rendre les critères de la langue principalement responsables des taux d’échec. De fait, c’est cette vision, issue d’une tradition persistante, qui s’est imposée dans le traitement médiatique. L’intégration dans l’épreuve uniforme de textes littéraires a par la suite posé le problème de la place des connaissances littéraires dans la compétence à écrire et a aussi suscité de vives réactions, au nom d’une certaine vision de la littérature.
Ce qui ressort en fin de compte, c’est que le construit sur lequel se fonde l’épreuve est souvent réinterprété selon les références de chacun. Il arrive aussi que certains le contestent quand il ne correspond pas à l’image qu’ils se font du bien-écrire. La vision sous-jacente à l’épreuve, son construit, s’oppose donc à une multitude de visions différentes. Par conséquent, une partie du débat actuel tient à la confrontation de différentes définitions de la maîtrise du français écrit.
La transformation des pratiques d’enseignement
L’effet de l’instauration de l’épreuve sur les pratiques d’enseignement a été très net. On conviendra que les taux d’échec catastrophiques, largement commentés par la presse, qui s’observaient il y a quelques années, ont secoué le milieu collégial. On a vu se produire une transformation très rapide des pratiques d’enseignement dans le but de rendre les étudiants aptes à réussir le test. Les programmes ont fait une place plus grande à la maîtrise du discours argumentatif et surtout à la connaissance des règles du code linguistique. Des stratégies pédagogiques ont été mises au point et diffusées à travers le réseau collégial afin de permettre le développement de ces compétences. Au prix des inévitables tensions que provoque un changement rapide des pratiques, on a vu se transformer les cours de français du collégial.
L’intervention pédagogique a même traversé les murs de la classe avec la mise sur pied de centres d’aide en français dont les approches, fort variées d’un établissement à un autre, faisaient une large place à des pratiques innovatrices avec l’application de principes issus de l’apprentissage coopératif, l’exploitation des technologies de l’information et de la communication, la responsabilisation des étudiants dans le déroulement de leur apprentissage, le développement d’habiletés métacognitives, etc. On trouve ici l’illustration du pouvoir que peuvent exercer les moyens d’évaluation sur les processus d’enseignement/apprentissage.
Une amélioration effective de la maîtrise de la langue
Dans le domaine de l’éducation, il est fréquent que des changements dans les pratiques ne se traduisent pas par des variations significatives dans les résultats à l’évaluation. Les causes sont nombreuses : manque de fidélité des mesures, validité contestable des tâches, multiplicité des facteurs en cause, échantillons trop restreints, conditions de collecte de données imparfaites, évolution des clientèles dans le temps, etc. Néanmoins, force est de constater que, dans ce cas, l’accroissement du taux de réussite est spectaculaire. Alors que, dans les premières années où l’épreuve était passée en vue de l’admission à l’université, on rapportait parfois que un étudiant sur deux avait échoué, les statistiques compilées à partir des résultats aux dernières épreuves uniformes font état d’un taux de succès supérieur à 90 p. 100 chez les candidats au préuniversitaire.
Cette augmentation n’est pas sans susciter un certain scepticisme (Painchaud, 1999). Certes, les normes de correction ont été modifiées : on peut penser aux problèmes de ponctuation, pour lesquels on pénalise moins lourdement les candidats, ou au barème fixé pour interpréter le nombre de fautes. Certes aussi, le contenu de l’épreuve a évolué : l’introduction de tâches associées à un type d’analyse littéraire pratiquée en classe ou l’explicitation des consignes ont transformé l’épreuve. Qui plus est, les équipes d’élaboration et de correction subissaient la pression sociale qu’engendraient des taux d’échec faramineux. Il n’en reste pas moins que le type de performance attendue n’a pas changé substantiellement de sorte qu’on peut interpréter les augmentations comme l’indication de progrès réels dans la maîtrise de la langue écrite. Il faudrait cependant une analyse statistique poussée des résultats des épreuves au collégial pour faire la part entre la variation attribuable aux changements dans l’épreuve et celle attribuable à l’évolution des compétences de la population visée.
Par ailleurs, une étude pancanadienne récente, menée par le Programme d’indicateurs de rendement scolaire (CMEC, 1999), montre que, chez les élèves francophones du secondaire, les résultats de 1998 en écriture sont supérieurs à ceux de 1994. On peut y voir l’effet d’un changement systémique auquel l’instauration d’épreuves officielles, tant au secondaire qu’au collégial, a certainement contribué.
Des stratégies de passation d’une épreuve de rédaction
La mise en place d’une épreuve officielle ne produit pas que des effets heureux. À l’amélioration des compétences visées se greffe le développement d’habiletés que Perrenoud associe au « métier d’élève » (Perrenoud, 1998). Ces habiletés permettent au candidat de maximiser ses résultats à une épreuve et jouent même un rôle compensatoire lorsque les compétences risquent d’être insuffisamment développées. Plus les conséquences d’un échec sont dramatiques, plus le phénomène est susceptible de se produire. Il peut s’agir de stratégies de passation de test : dans le cas de l’épreuve de français, l’étudiant pourra réaliser un texte en reproduisant un modèle générique, limiter les occasions d’erreurs en se confinant à des structures grammaticales simples, aligner son contenu dans le sens de la désirabilité sociale, recourir à une langue de bois et même, dans quelques cas, carrément plagier. Certaines de ces habiletés apparaissent socialement plus acceptables : mieux gérer le temps imparti, soigner la calligraphie et la disposition, exploiter le matériel de référence.
Le développement de ces habiletés se traduit souvent par une forme de bachotage, c’est-à-dire un travail intensif en vue de réussir le test plutôt que de véritablement mettre en place les éléments de compétence pour mieux écrire. Ce bachotage peut même être renforcé par du matériel conçu à cette fin ou par un enseignement systématique orienté dans ce sens. Quand cela se traduit par des stratégies propres à la situation de test, c’est-à-dire des stratégies qui ne peuvent pas être transférées dans des situations réelles de réalisation de tâches apparentées, on peut mettre en doute la validité de la mesure. Il y a certainement lieu de s’interroger sur la pertinence de mettre en place une épreuve s’il s’avère que les stratégies de passation prennent le pas sur les compétences visées. Il faut cependant souligner que, malgré certains comportements observables, et souvent décriés, rien ne permet pour l’instant de dire que les stratégies de passation jouent un rôle démesuré dans les épreuves uniformes.
Que conclure ?
Les effets de la mise en place de l’épreuve de français au collégial sont incontestables. L’instauration de l’épreuve a contribué à sensibiliser les divers acteurs à l’importance de bien maîtriser la langue écrite et à répandre une conception de ce qu’on doit entendre par cette maîtrise. Il serait cependant important de pouvoir éventuellement dégager les différentes conceptions qui s’affrontent pour vérifier jusqu’à quel point l’épreuve comble les attentes des principaux acteurs. Par ailleurs, il est évident que, en peu de temps, les pratiques pédagogiques se sont radicalement transformées en vue d’assurer la réussite des étudiants. Au-delà des effets attribuables aux modifications apportées à la nature des tâches et aux normes de correction, il semble bien que les compétences en écriture se sont améliorées. Il reste cependant à vérifier si cette amélioration est aussi sensible qu’on pourrait le croire, si elle se traduira par des compétences transférables dans diverses situations d’écriture. Il faudra aussi voir le chemin qu’il reste à faire pour atteindre les performances idéales.

CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION DU CANADA. Évaluation 1998 en lecture et écriture du PIRS : le rapport public, Toronto, CMEC, 1999. http://www.cmec.ca.
FREDERICKSEN, J. R. et COLLINS, A. « A system approach to educational testing », Educational Researcher, vol. 18, n° 9, 1989, p. 27-32.
MESSICK, S. « Validity » dans R. L. Linn (dir.), Educational Measurement, 3e édition, New York, ACE/Macmillan, 1989, p. 1-108.
MOSS, P. A. « The role of consequences in validity theory », Educational Measurement : Issues and Practices, vol. 17, n° 2, 1998, p. 6-12.
PAINCHAUD, A. « Des résultats bidon ? L’examen ministériel de français au collégial », Le Devoir, 8 février 1999.
PERRENOUD, Ph. L’évaluation des élèves, Paris, Bruxelles, De Boeck Université, 1998.
SHEPARD, L. « The centrality of test use and consequences for test validity », Educational Measurement : Issues and Practices, vol. 16, n° 2, 1998, p. 5-8, 13, 24.
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications