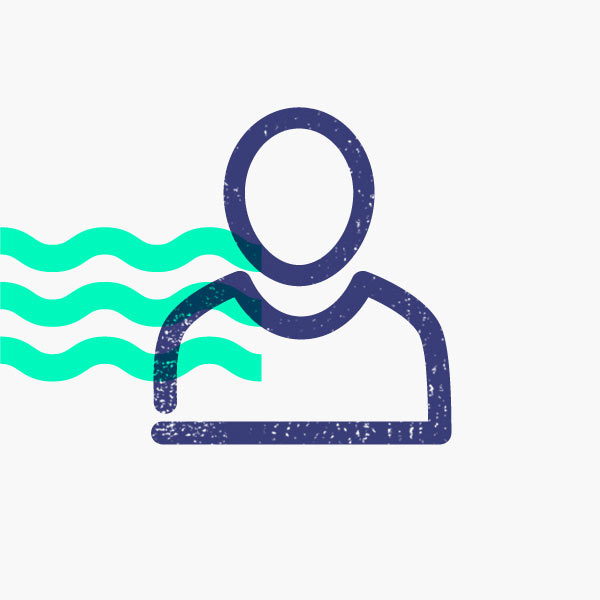L’acculturation à la communication scientifique: nécessité et embuches
Cet article aurait pu s’intituler « Dix ans plus tard ». En effet, en mars 2001, Georges Legros et moi-même terminions un article pour Correspondance[1] sur l’esquisse d’une orientation nouvelle à donner aux « remédiations » de l’époque en matière de maitrise[2] de la langue, dispositif que nous venions de détailler : « […] permettre à un plus grand nombre d’étudiants de s’adapter à une nouvelle « culture », de se forger progressivement une nouvelle identité (au moins intellectuelle) ; mais c’est là une autre histoire, à partager ultérieurement, peut-être… ». Nous vous invitons donc à partager cette nouvelle étape de l’histoire[3], avec un rapide rappel préliminaire de la précédente.

Lorsqu’il a été instauré, le dispositif d’encadrements spéciaux centrés sur la maitrise de la langue écrite destiné aux étudiants entrant en Faculté de philosophie et lettres découlait de deux constatations principales. D’une part, cette compétence dans cette filière d’études, où les étudiants sont amenés à travailler souvent à partir de textes et à en produire, s’imposait (et s’impose toujours) comme prioritaire ; de plus, les enseignants déploraient des carences apparemment croissantes chez les étudiants dans ce domaine, ce qui méritait d’être pris en compte[4]. D’autre part, on postulait qu’une bonne maitrise de la langue serait un facteur propice à la réussite, que de récents décrets ministériels invitaient les universités à favoriser.
La nécessité d’intervenir
Nous avions opté pour l’organisation d’une épreuve diagnostique la première semaine de cours et, ensuite, de remédiations échelonnées sur le premier semestre. L’épreuve, imposée à tous les étudiants entrants, comportait deux parties : un test formel relatif à des connaissances lexicales[5] et orthographiques ainsi qu’à la compréhension d’articulations logiques, et une production textuelle (rédaction d’un texte d’une page à partir d’un sujet en rapport avec les thèmes de la filière d’études). Les modules de remédiation (de 4 à 8 heures chacun), proposés et non imposés, étaient centrés, pour la plupart, sur des « microhabiletés » normatives (points sensibles d’orthographe, syntaxe de la phrase complexe) et discursives (certains aspects de la composition textuelle). Généralement, on y adoptait la méthodologie suivante : observation d’extraits de copies d’étudiants (provenant des tests et de divers cours) débouchant sur des classements de dysfonctionnements ; formalisation ; réinvestissement dans l’écriture de petits textes (fournissant une nouvelle matière à corpus). Parallèlement était proposé un module à la charnière du cognitif et du linguistique, visant un savoir-faire particulièrement sollicité : l’analyse de questions et l’élaboration de schémas de réponse adéquate. Là aussi, on favorisait la contextualisation par les supports utilisés (questions émanant des tests disciplinaires et des copies d’étudiants) et la métacognition (exercice d’une démarche d’analyse pour classer des réponses selon leur degré d’adéquation, précédant une formalisation des « postures » à développer).
Dès le départ donc, par rapport à notre objet, en l’occurrence l’expression écrite, et à notre objectif, en améliorer la maîtrise chez les étudiants, certaines options avaient été choisies : pédagogique, avec le principe du volontariat ; didactique, avec l’organisation d’un test diagnostique articulé autour des remédiations ; méthodologique, avec l’usage de productions authentiques et la sollicitation d’un travail métacognitif.
Dans sa phase actuelle, le dispositif fonctionne globalement selon les mêmes options, mais certains glissements se sont produits à la faveur de l’expérience et de l’apport de certaines recherches menées dans le champ ici traité, notamment avec le développement du concept de « littéracie[6] ». Ainsi, l’épreuve diagnostique s’est-elle progressivement délestée de la partie formelle au profit d’une centration sur le « lire-écrire », deux savoir-faire que les didacticiens de la langue considèrent comme indissociables dans l’acquisition des compétences langagières.
Rejoignant d’une certaine manière ces avancées théoriques, une recherche interne menée aux FUNDP et portant sur les préalables avait notamment montré que les enseignants de lettres interrogés mettaient en évidence l’aptitude à la « compréhension fine » davantage que les préalables strictement disciplinaires chez les étudiants entrants. Une part de cette recherche ayant consisté en l’élaboration d’outils de mesure des préalables (testés et validés), celui relatif à la compréhension fine (lecture d’un texte d’un niveau complexe, réponse à un questionnaire) a été repris et modulé de façon à associer une observation des stratégies de lecture mises en œuvre par les étudiants et quelques aspects de la compétence rédactionnelle exercée à partir du même support.
Ce changement, qui a conduit à la création d’un module sur les stratégies de lecture incluant les compétences discursives (en réception et en production), a radicalisé la modification progressive déjà en cours des modules de remédiation ; cette opération avait mené l’équipe à minimiser peu à peu le travail sur les microhabiletés précitées en matière d’orthographe et de syntaxe dans les modules offerts à tous. En effet, d’évidence, des activités « en plus » sur la langue, non inscrites dans leur cursus disciplinaire, n’incitaient pas la plupart des étudiants à s’y investir ni à croire en leur utilité. Nous avons donc cherché une stratégie plus porteuse dans le développement d’un partenariat avec des enseignants disciplinaires responsables des travaux écrits de leurs sections respectives[7].
Cet attelage interdisciplinaire, qui associe, dans la phase d’élaboration du travail écrit, le spécialiste de la langue à l’enseignant de qui dépend l’évaluation certificative dans une discipline, avait en effet paru de nature à crédibiliser davantage auprès des étudiants un travail sur les compétences langagières en le contextualisant et en le finalisant (réussir un travail noté pesant dans l’évaluation certificative globale en fin d’année). Cette importance accordée à l’ancrage s’appuie sur la thèse, largement diffusée depuis une vingtaine d’années dans les théories du discours et de la linguistique pragmatique, que la compétence langagière d’un sujet, à fortiori à l’écrit, n’est pas dégagée des contextes où elle s’exerce. Le premier de ces contextes, en l’occurrence, c’est l’habitus universitaire, où la communication (écrite en particulier) répond à des attendus et à des prescrits implicites peu connus des étudiants débutants, qui ne sont pas familiers avec ce type d’écrits ; le second, c’est la discipline où s’exerce cette communication scientifique qui, elle aussi, a ses règles.
Notre objet de départ, l’expression écrite, a donc été progressivement requalifié de « compétences langagières » (affectant la réception et la production : le « lire-écrire »), et notre objectif, l’amélioration de ces compétences, s’est intégré dans celui de l’acculturation aux études universitaires, en ciblant une de ses facettes : l’acculturation à la communication scientifique.
Qu’avons-nous ainsi amélioré ? Ce nouveau dispositif est-il plus efficace ? Quels obstacles rencontre-t-il ? À quelles questions ouvre-t-il, au-delà du bien-fondé de certains modèles théoriques ou principes qui en ont inspiré les options pédagogique, méthodologique et didactique ?
Imposer l’épreuve diagnostique à tous les étudiants entrants s’inscrit dans une pédagogie du « contrat didactique » dont on escompte des effets sur les comportements. Ainsi, donner dès le départ des indices qui permettent, d’une part, de construire une représentation des exigences de correction normative et d’adéquation discursive qui régiront dorénavant la communication et, d’autre part, de se situer par rapport à de nouveaux critères d’évaluation, devrait, in abstracto, conduire les étudiants ayant des résultats mauvais (≤ 8/20) ou médiocres (≥ 9 ≤11) – qui constituent la population à risque[8]– à profiter des remédiations.
Les embuches liées à l’intervention
Empiriquement, c’est moins évident. On constate que fréquentent les remédiations 36 à 40 % des étudiants ayant de mauvais résultats, 29 à 35 % de ceux ayant des résultats médiocres, et 14 à 19 % de ceux dont les résultats sont ≥ 12. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour tenter d’expliquer ce qu’on ne peut considérer comme un échec du dispositif (en termes de fréquentation à tout le moins), mais comme un symptôme alarmant.
La précocité du test, combinée à l’absence de sanction (intrinsèquement liée au fait qu’il s’agit d’un diagnostic et non d’une épreuve certificative qui « compterait »), est sans doute pour certains peu incitative. Quoi qu’il en soit du commentaire qui accompagne la publication des résultats (qui met notamment l’accent sur l’indice de corrélation entre le résultat au test et la réussite de l’année), une forme de déni est repérable dans l’attitude qui consiste à considérer la contre-performance comme accidentelle (ce qu’elle est sans doute dans certains cas) ou à reporter le traitement du problème[9].
La libre participation aux modules est une autre explication. Cette option repose sur le principe de l’autonomisation, dont la justification pédagogique est évidente. Mais, force est de constater qu’on se heurte à une forme d’immaturité chez les étudiants qui sont en début de cursus. L’effet de rupture escompté, à savoir la prise de conscience d’un changement de régime (entre l’enseignement secondaire, où le cadrage est individualisé, et l’université, où il ne l’est plus) et l’adoption conséquente de nouveaux comportements, ne se produit pas chez une majorité d’entre eux. Peu font preuve d’une autonomie suffisante à ce stade pour prendre une distance par rapport à eux-mêmes. Dès lors, ils ne dissocient pas un jugement sur la personne d’un jugement sur l’habileté à résoudre une tâche. On peut faire l’hypothèse que cette confusion est un facteur de blocage chez certains : le diagnostic n’est pas pris pour ce qu’il dit de défauts potentiels dans la mise en œuvre de la résolution d’une tâche ni pour ce qu’il ouvre donc de remédiable.
Par ailleurs, la distance réflexive qu’implique la posture métacognitive requise dans le déroulement des modules et des interventions en partenariat ne va pas de soi non plus. Ce choix méthodologique se fonde là encore sur une conception assez largement répandue : la compréhension des mécanismes que l’on met en œuvre pour réaliser une tâche favorise sa réalisation et l’acquisition d’automatismes qui la rendront progressivement moins complexe. Nonobstant la mise en place d’une méthodologie pour la faciliter (support d’un questionnaire, échanges par petits groupes), cette posture reste peu accessible aux étudiants les plus faibles. Le démontage des mécanismes liés à la lecture- compréhension fine (de textes ou de consignes) ou à la posture énonciative requise par la situation de communication (qu’il s’agit donc de pouvoir identifier), d’une part, et la mise en œuvre d’outils d’analyse pour la révision de texte (repérage de défauts de cohérence, notamment), d’autre part, réclament, en effet, un type d’investissement cognitif qui non seulement fait appel à une certaine capacité d’abstraction, mais est aussi de moins en moins familier, à tout le moins appliqué aux objets langagiers sur lesquels nous nous focalisons. En effet, dans l’enseignement secondaire, ceux-ci ne donnent plus lieu qu’occasionnellement à des activités impliquant cette posture[10].
Se pose également le problème du transfert. Force est de constater que rendus à eux-mêmes, en tâche sur leurs propres travaux, bon nombre d’étudiants ont du mal à transférer ce qui a été mis en place dans les séances d’encadrement. Une part de l’explication tient sans doute à la durée exploitable de ces séances. En effet, qu’il s’agisse des modules liés au test diagnostique, de ceux consacrés aux stratégies d’analyse de consignes et de construction de schémas de réponse adéquate à la question, ou encore, des encadrements interdisciplinaires cités plus haut, le nombre limité de séances ne permet pas, ou permet trop peu, d’exercer et d’appliquer les démarches de manière que les étudiants puissent les intégrer dans un processus de maturation suffisante. Or, de réelles compétences en ce domaine postulent, comme pour l’acquisition des savoirs[11], que des réinvestissements puissent avoir lieu, en variant les supports et les contextes.
Cette durée d’apprentissage, en ce qu’elle n’apparait pas directement dévolue aux savoirs enseignés eux-mêmes, n’est en général pas ou est peu valorisée par les enseignants universitaires, peu prompts dès lors à réduire le temps consacré à la transmission de la masse des connaissances (qui impliquerait des adaptations didactiques) au profit d’un temps « pédagogique ». Ils sont souvent peu conscients du fait que les étudiants, tout en disposant, certes à des degrés divers, de compétences transversales de lecture-écriture, doivent les adapter à un nouvel habitus de communication des savoirs, et donc acquérir une nouvelle compétence. Et cette absence ou ce manque de valorisation chez les enseignants ne peuvent qu’entraîner son décalque chez les étudiants.
En instaurant un partenariat avec certains enseignants disciplinaires pour les travaux écrits, on espérait agir en partie sur cet état de choses. Le fait est que l’enjeu du temps à consacrer aux compétences rédactionnelles est plus palpable pour les étudiants dès lors que la production finale « va compter » dans un ensemble de notes certificatives. L’expérience en cours tend pourtant à montrer qu’on se heurte globalement aux mêmes écueils concernant le transfert, alors que l’assistance aux séances est, dans ce cas, théoriquement obligatoire et s’étale sur une durée plus longue (8-10 semaines). L’organisation prévoit, en effet, des séances, les unes collectives, les autres en petits groupes, à certaines étapes de l’élaboration du travail, et une consultance individuelle en présentiel ou en ligne (soumission de parties de texte et de questions portant sur sa composition).
Quand on constate que sur la masse d’étudiants concernés par cette pratique (±180), 10 à 15 % seulement réalisent les tâches intermédiaires pour les séances programmées et utilisent la possibilité de consultation seulement la semaine avant l’échéance (moment où la sollicitation devient alors plus sensible), il apparait clair que la durée n’est pas mise à profit. La plupart des étudiants n’ont pas intégré l’idée – malgré, encore une fois, le discours tenu à cet égard et toutes les représentations que l’on tente de construire – que la phase rédactionnelle tout autant que celle de l’élaboration du matériau (recherche) requièrent un investissement long, fait de reprises et d’ajustements constants (comme le savent bien les scripteurs experts).
Ne bute-t-on pas là sur quelque chose comme un « savoir-être » ? Plus que d’une aptitude de départ, n’y va-t-il pas d’une attitude adéquate à la situation ? Mais agir efficacement sur ce terrain du « savoir-être » n’est certainement pas moins difficile que d’agir sur celui des « savoir-faire », « savoir-faire » où l’on retrouve la question de l’autonomisation : on ne peut manifestement pas tabler, pour la majorité des étudiants concernés, sur l’adoption précoce et spontanée de l’attitude adéquate impliquant, pour la plupart, de transformer des comportements qui, jusqu’alors, se sont révélés payants (réussite des études secondaires). Les étudiants, du moins les plus fragiles ou ceux de la frange critique, ont du mal à opérer les changements propres à influencer positivement leurs chances de réussite.
Faut-il en (re)venir à un système plus coercitif ? Par exemple, pour l’encadrement interdisciplinaire dont il a été question, pondérer la note finale du travail en fonction de la réalisation des étapes intermédiaires (ce qui revient à mêler évaluations formative et certificative, et soulève dès lors d’autres questions) ? Ou, pour les modules liés au test diagnostique, rendre obligatoire la participation des étudiants dont le résultat est en deçà d’un certain seuil ? Nous l’avons tenté, mais sans effets probants quant à l’efficacité et au taux de participation, faute de l’adjuvant que serait un système de contrôle et de sanction. S’il fallait l’instaurer, cela impliquerait que soient validées les activités réalisées, qui demanderaient sans aucun doute alors à être développées.
Cette question de la validation des encadrements en compétences langagières m’amène au dernier point de cette réflexion. Si les références théoriques touchant au domaine disciplinaire des compétences rédactionnelles et de leur enseignement confèrent à notre pratique, fondée sur un certain empirisme, une forme de caution, ce sont bien évidemment les résultats qu’elle produit qui fourniraient le meilleur indicateur. Mais il n’est pas nécessaire d’expliquer longuement pourquoi une mesure de l’impact n’est guère possible. D’une part, ce qui concourt à la réussite scolaire est multifactoriel et il est difficile, voire non pertinent, d’isoler une variable. D’autre part et surtout, l’évaluation des compétences langagières n’est jamais isolée comme telle, en ce sens qu’une note indépendante viendrait en sanctionner le degré de maitrise.

Notre tâche reste pour le moment ardue parce que les enjeux n’en sont pas encore bien perçus. Notre objet, l’acculturation à la communication scientifique et le travail des compétences langagières dans ce cadre, reste d’ailleurs souvent mal compris par nos collègues (qui le réduisent encore trop fréquemment à la connaissance de la norme, voire à l’un de ses aspects : l’orthographe[12]). Il se caractérise en outre par une imbrication de paramètres qui, pour être travaillés plus efficacement, réclameraient des modifications dans la didactique des disciplines. Donner plus de place à la « construction langagière » du savoir dans la diffusion des connaissances disciplinaires présupposerait de la part de la communauté des enseignants une appréhension plus « informée » du rôle du langage dans l’acquisition des savoirs et des savoir-faire. Déjà amorcée avec la création de premiers partenariats, notre action nous parait donc devoir être menée sur ce front-là aussi. Notre équipe est convaincue qu’une transformation des représentations chez les enseignants est l’une des voies incontournables pour favoriser la réussite des études supérieures chez les étudiants.

Références
BAUTIER, É. (s.d.). Les différentes dimensions de la maîtrise de la langue et leur évaluation. www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/j_acad/pdf/compte_rendu_03-04-25/bautier.pdf
MONBALLIN, M., et E. MAGOGA (2002). « Pour une mise en perspective des difficultés langagières à l’écrit », Enjeux, n° 53, p. 128-137.
POLLET, Marie-Christine. (2001). Pour une didactique des discours universitaires, Bruxelles, De Boeck.
THYRION, François. (2000). « L’évaluation de la maîtrise du français au supérieur : au-delà de la maîtrise du code, les aspects cognitif et discursif », dans J.-M. DEFAYS, M. MARéCHAL et S. MéLON (éd.), La maîtrise du français. Du niveau secondaire au niveau supérieur, Bruxelles, De Boeck, p. 191-202.
VANHULLE, S., et A. SCHILLINGS (2003). La « littératie » : métaphore idéologique ou concept didactique ? www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/A005/rapfin/SVanhulle1.pdf
- « La maitrise du français à l’entrée des études supérieures : mythes, constats et interventions », Correspondance, vol. 6, n° 4, 2001. [Retour]
- Ce texte est rédigé conformément aux rectifications orthographiques en vigueur. [Retour]
- La conception et la mise en œuvre des dispositifs dont il va être question, de même que le questionnement constant qui les accompagne, sont le fruit d’une petite équipe, dont je me fais ici l’écho. Hommage soit ainsi rendu aux chevilles ouvrières qui « sur le terrain » n’ont de cesse de trouver le sésame qui ouvrirait aux étudiants de meilleures performances dans les tâches d’écriture qui leur sont imposées. [Retour]
- La complainte, largement répandue, est connue : orthographe déficiente, syntaxe approximative, lexique pauvre et imprécis, discursivité présentant des défauts dans ce qu’on appelle la « cohérence textuelle » (articulation et progression du propos). [Retour]
- Les mots testés avaient été choisis selon deux critères : termes de registre abstrait souvent utilisés dans les cours n’appartenant pas à un lexique spécialisé (ne faisant, donc, l’objet d’aucune explicitation) ; termes dont on avait constaté la mauvaise maitrise. [Retour]
- Le concept fait l’objet de nombreuses discussions et interprétations. On s’en tiendra ici à ce qui semble faire plus ou moins consensus, en reprenant partiellement la formulation qu’en donnent Vanhulle et Schillings (2003) : « […] la littératie désigne un continuum de compétences de lecture, écriture […] permettant de s’adapter facilement à toute une série de situations de vie. Ces compétences vont, au minimum, d’une bonne maîtrise du code à la capacité d’interpréter des textes plus ou moins chargés d’implicite et faisant appel à des connaissances préalables. » [Retour]
- En nous inspirant de l’expérience de Marie-Christine Pollet (2001), mais selon des modalités concrètes différentes. [Retour]
- Diverses corrélations des résultats du test diagnostique avec la réussite de l’année (toutes sessions confondues) montrent que de 74 à 82 % de ceux ayant une note ≤ 8 et de 63 à 72 % de ceux ayant une note < 12 échouent. [Retour]
- Ce profil d’étudiant se rencontre d’ailleurs à d’autres moments d’évaluation (tests du premier semestre ou examens de la session de janvier). Le discours tenu est généralement : « Tout ira mieux quand je me mettrai à étudier/à travailler davantage. » La procrastination n’est certes pas un phénomène nouveau. Mais elle reste difficile à appréhender en profondeur, en ce qu’elle implique d’autres paramètres touchant au « savoir être » (voir plus loin). [Retour]
- C’est un constat et non l’expression d’un regret. En Belgique francophone, les programmes scolaires de français ont considérablement diversifié les objets d’enseignement ainsi que les approches. L’apprentissage de la grammaire s’est vu battu en brèche et reste à l’heure actuelle peu cadré par les programmes, ce qui génère beaucoup d’hétérogénéité. Par ailleurs, l’ouverture des options a eu pour effet, par exemple, la diminution notoire du nombre d’élèves suivant la filière des langues anciennes, où s’exerçait continuellement une réflexion sur la langue (analyser pour traduire). Ces deux facteurs jouent sur l’apprentissage de l’écrit. Les élèves y sont globalement moins aguerris : nombre réduit de travaux ou grande variété des types de textes à produire, ce qui ne favorise pas l’intégration de certains paramètres transversaux de l’écriture ni de certains modèles discursifs plus proches de ceux caractérisant la communication scientifique. [Retour]
- Pour être vraiment assimilés et devenir opérationnels, les savoirs doivent pouvoir être recontextualisés, réagencés, repensés pour donner lieu à de nouveaux investissements. L’organisation conceptuelle des connaissances doit avoir été non seulement mémorisée, mais également mise à l’épreuve de la reformulation, du questionnement, de l’application à des situations diverses. [Retour]
- Ces collègues estiment que la maitrise pourrait se reconstruire au moyen de quelques cours de grammaire, ce qui est méconnaitre la complexité du système du français et surtout le rapport à la langue (dimensions affective et sociale) qui est derrière les déficits et qui implique autre chose qu’une « simple » connaissance de règles. Tout en déplorant le nombre de fautes dans les copies, en fait, ils ne les sanctionnent pas (ou les sanctionnent très peu) dans leurs évaluations. Accordant la priorité aux informations, ils ne prennent en compte les compétences linguistiques et discursives que si les erreurs et maladresses entravent très sérieusement la compréhension de ces informations ou si, au contraire, la maitrise de la langue constitue un atout supplémentaire qui permet de majorer la note. [Retour]
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications