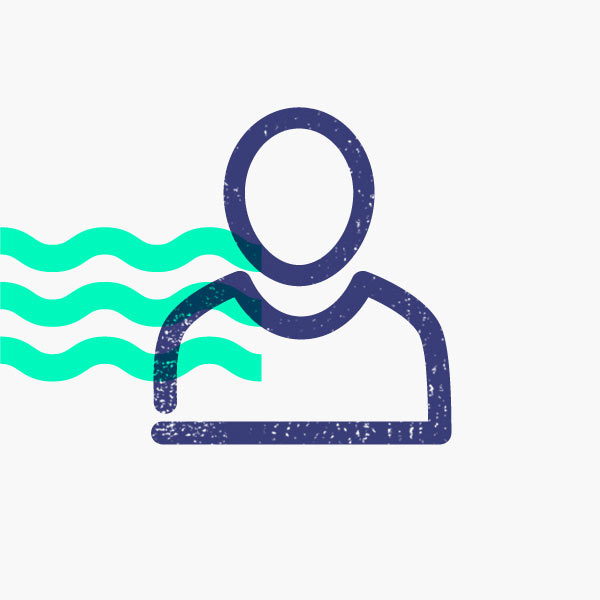L’anglomanie en Belgique francophone
Depuis 1964 année où Étiemble publia son célèbre Parlez-vous franglais ?, nombreux sont les chercheurs qui ont étudié le foisonnement des expressions et des mots anglais ou pseudo-anglais dans la langue française contemporaine. La partie francophone de la Belgique n’est pas en reste dans ce concert, avec entre autres les publications d’André Goosse (La néologie française aujourd’hui. Observations et réflexions, 1975), de Joseph Boly (Chasse au franglais, 2e éd., 1979), d’Albert Doppagne (Pour une écologie de la langue française, 2e éd., 1980), de Michèle Lenoble-Pinson (L’anglicisation de Bruxelles. Le franglais, 1986 – pour ne nommer ici que l’un des écrits de l’auteure sur la question[1]).
Parmi toutes ces recherches, la Maison de la Francité, située à Bruxelles, a joué un rôle particulier. Au début des années 80, son directeur, André Patris, mettait sur pied avec le concours de la lexicologue M. Lenoble-Pinson, et plus tard de Michel Trousson, l’« Atelier de vocabulaire », qui rassemblait des personnalités issues de divers milieux professionnels : enseignants, journalistes, publicitaires, informaticiens, fonctionnaires, traducteurs, responsables commerciaux, linguistes, grammairiens. Il s’agissait de recueillir le témoignage des uns et des autres en matière de pratique linguistique actuelle, mais aussi d’analyser systématiquement un certain nombre d’anglicismes courants et de proposer pour chacun d’entre eux un équivalent français convaincant. Les fiches résultant de ces travaux furent publiées dans une revue créée à cet effet, Questions de français vivant (1984-1993), puis dans le périodique Francité[2].

Parallèlement, la Maison de la Francité collaborait à l’édition de brochures illustrées destinées au grand public, comme Images du franglais chez nous (Association de Communauté française, 1985) et Bruxellois, ton français file à l’anglaise (Assemblée de la Commission communautaire française, 1993), ou encore, au lexique Anglicismes et substituts français (M. Lenoble-Pinson, 1991). Plus récemment, cette dernière a publié sous le titre Notre français file à l’anglaise (2009) une étude sur l’anglomanie dans les messages publics diffusés dans la région bruxelloise, et regroupés pour l’occasion en cinq secteurs : officiel et semi-officiel, culturel, commercial, radio-télévision, presse écrite ; le tout est complété par deux lexiques, l’un des anglicismes à éviter, l’autre des emprunts admis, mais aussi par une réflexion sur les causes de l’anglomanie, ses dangers et ses remèdes.
Qu’est-ce qui explique cet intérêt soutenu pour un phénomène qu’on aurait pu croire à première vue marginal ? Il faut rappeler que, du point de vue linguistique, la région bruxelloise se caractérise par une grande complexité, et même par une certaine instabilité. « Cap nord de la francophonie », selon l’expression connue, elle est à la charnière du monde latin et du monde germanique, ce qui fait d’elle un espace culturel de mixité et de confrontation marqué par le multilinguisme. Ses langues officielles sont le français et le néerlandais, idiomes des deux communautés les plus nombreuses du pays ; mais, dans leurs rapports avec les administrations publiques, 90 % des Bruxellois font le choix du français. À égalité dans les messages officiels et semi-officiels (dans les transports urbains, par exemple), les deux langues présentent donc dans la population une implantation très inégale : cet écart entre légalité et réalité explique la récurrence des divers tiraillements et comportements abusifs dont sont victimes les francophones à Bruxelles.
L’on découvre ici l’un des grands moteurs de l’« anglomanie » bruxelloise. Beaucoup d’annonceurs – culturels, commerciaux ou autres – cherchent à faire l’économie du bilinguisme, qui leur parait[3] encombrant ou disgracieux, et recourent pour cela à un idiome réputé « neutre » et même « universel », à savoir l’anglais. Par ailleurs, s’étant rendu compte que leur langue est et restera minoritaire dans la région, plusieurs responsables flamands préconisent l’utilisation de l’anglais pour marginaliser le français, le réduire à une composante parmi d’autres dans le landerneau polyglotte bruxellois. Entre autres, un exemple frappant de cette politique est donné depuis de longues années par le Palais des Beaux-Arts, renommé « Bozar », dont la communication externe (affiches, prospectus, signalisation dans le « bookshop », etc.) est en permanence truffée d’anglais.
Un troisième facteur doit être évoqué : l’implantation dans la région bruxelloise de grandes institutions internationales, particulièrement de la Commission européenne. Il n’est un secret pour personne que, dans les institutions européennes, l’anglais est en passe de devenir la langue véhiculaire du personnel, sinon des parlementaires et de tous ceux qui gravitent autour, de sorte qu’aucun d’eux ne pourrait se permettre d’ignorer cette langue. Or, toutes ces personnes vivent à Bruxelles ou dans sa périphérie, y consomment, utilisent ses administrations, ses écoles, ses lieux culturels ou sportifs – et ne font pas toujours l’effort d’apprendre la langue principale de la région, tant s’en faut. Elles exercent donc sur les commerçants et les autorités une pression quotidienne afin qu’on les accueille en anglais dans le plus grand nombre possible de lieux publics. Il est vrai que, en l’occurrence, il s’agit moins de l’envahissement du français par l’anglais que de son remplacement pur et simple…
Il n’est pas facile d’évaluer avec précision l’ampleur de l’anglomanie qui touche le français dans la région bruxelloise. Pour ce faire, il faudrait délimiter un corpus (trois quotidiens durant un mois complet, par exemple), compter le nombre d’anglicismes (après avoir défini ce terme avec exactitude) qui y apparaissent, puis recommencer chaque année afin de mesurer l’évolution du phénomène. Contentons-nous d’observations plus restreintes. La figure 1 présente par ordre croissant le pourcentage d’enseignes en anglais selon une enquête menée dans différentes zones commerçantes de Bruxelles, il y a une quinzaine d’années. Un comptage réalisé en 2011 révèlerait sans aucun doute une augmentation moyenne minimale de 10 % des chiffres de la figure 1.
| Lieux | % |
| avenue Louise (de la porte Louise à la rue Lesbroussart) | 17 |
| rue Neuve | 26 |
| Woluwe Shopping Center | 29 |
| Stockel Square | 33 |
| Anderlecht Westland Center | 35 |
| Basilix | 38 |
| City 2 | 45 |
| Bruparck | 60 |
Plus récemment (novembre 2005), la Maison de la Francité a réalisé une enquête dans différents médias : Le Soir, Métro, Vlan, le Journal Parlé de la RTBF, l’émission télévisée Au quotidien. Ce dépouillement a permis de relever dans la presse écrite 550 termes anglais différents, certains revenant un grand nombre de fois. La figure 2 présente les plus fréquents, soit ceux qui apparaissent 13 fois ou plus. Quant à l’écoute des émissions radio, elle a permis de noter, entre beaucoup d’autres, les termes présentés à la figure 3.
| show | 50 fois |
| leader, leadership | 49 |
| business | 42 |
| manager, management | 41 |
| star | 34 |
| coach, coacher, coaching | 33 |
| marketing | 26 |
| interview | 21 |
| shopping | 21 |
| e-mail, mail | 19 |
| dope | 18 |
| match | 17 |
| design, designer | 16 |
| fan | 16 |
| road show | 16 |
| challenge | 15 |
| stress | 15 |
| label | 14 |
| Net | 14 |
| look | 13 |
| people, peopelisation | 13 |
| teaser, teasing | 13 |
| best of | masters (tennis) |
| best-seller | outsider |
| booster (« booster l’accès au logement social ») | package |
| box-office | screening (« chez ces personnes, il faut cibler le screening du diabète ») |
| cash (paiement) | sponsor et sponsoriser |
| crash et crash-test | staff (football) |
| go between | stand by (en) |
| hit-parade | tax-on-web |
| live (enregistrement) | workshop |
| lobby | zapper et zappeur |
Du point de vue statistique, on peut noter la similitude des chiffres entre, d’une part, l’enquête de Doppagne et Lenoble-Pinson (Le français à la sauce anglaise, 1982 ; à partir de 42 numéros du quotidien bruxellois Le Soir parus en 1979) et, d’autre part, celle de la Maison de la Francité (2005) : 544 anglicismes d’un côté, 550 de l’autre. Certes, ce ne sont pas entièrement les mêmes. Doppagne ne relève ni best of, ni booster, ni call center, ni making of, ni press book, ni scanner, ni start up… De plus, les corpus examinés ne sont pas identiques. Néanmoins, d’une enquête à l’autre, le nombre global de termes anglais différents semble être resté à peu près stable. Par contre, la brochure Notre français file à l’anglaise (2009) fournit indirectement une information quantitative un peu différente : le « glossaire des anglicismes à éviter », en effet, compte 309 entrées, et le « glossaire des emprunts admis » 394, ce qui donne un total de 703 mots différents. Or, tous ces mots peuvent être considérés comme relevant du vocabulaire courant, dans la mesure où ils apparaissent dans la presse quotidienne.
Sans même tenir compte de la terminologie technique et scientifique – comme nous le faisons dans le présent article –, il semble donc bien que l’utilisation de mots anglais dans la communication francophone connaisse à Bruxelles et plus généralement en Belgique une courbe ascendante. Ce qui est en cause est un double phénomène : d’une part, des mots nouveaux font leur entrée dans le lexique français ; d’autre part, ces mots reviennent de plus en plus fréquemment dans les énoncés oraux et écrits, spécialement dans la presse et dans la publicité. Ainsi, lors de la « réforme Copernic » des services fédéraux, les journalistes ressassaient- ils e-government par ci, top manager par là, back ground ou assessment un peu plus loin… On le constate dans ces exemples, un troisième phénomène s’ajoute aux deux précédents : contrairement à ce qui s’est fait pendant longtemps, les emprunts à l’anglais ne sont plus francisés dans leur graphie et leur prononciation.
Au fait, et sans tomber dans l’ornière du purisme, cette anglomanie présente-t-elle de véritables inconvénients en matière de communication ? Les Bruxellois que nous avons interrogés considèrent souvent la chose avec légèreté. Les adolescents et les jeunes adultes trouvent un plaisir manifeste à utiliser des vocables anglo-américains, qui leur paraissent plus « modernes » ou plus « branchés ». Les journalistes spécialisés en sport ou en économie, par exemple, estiment qu’ils paraitront plus compétents s’ils recourent au jargon du métier. Les personnes plus âgées se contentent de subir le phénomène avec fatalisme, comme une mode un peu agaçante. Toutefois, une analyse plus approfondie fait apparaitre au moins trois effets négatifs appréciables : l’ambigüité accrue des messages, une compétence lexicale en baisse, un apprentissage plus difficile pour les non-francophones.
Reprenons ces trois points. D’abord, il est peu contestable que, pour le Bruxellois moyen (rappelons que l’anglais n’est pas langue officielle en Belgique), la présence d’anglicismes dans les messages publics a pour effet d’obscurcir la communication ; même pour ceux qui connaissent l’anglais, certains mots de cette langue, employés dans un sens inhabituel ou inédit, restent énigmatiques, rejoignant ainsi le domaine du jargon. S’il s’agit d’un simple article dans un périodique, le mal n’est pas bien grave. Mais si le message présente un aspect pratique indispensable (par exemple, dans une grande gare ou un aéroport, comme les enquêtes précitées l’ont montré), son destinataire peut se trouver dans une situation embarrassante.
Ensuite, on constate que l’emploi de locutions et de mots anglo-américains entraine, surtout chez les jeunes francophones, une ignorance grandissante quant au vocabulaire de leur langue maternelle. Bien souvent, en effet, c’est de manière tout empirique qu’ils apprennent à connaitre et à utiliser ces locutions et ces mots, de sorte qu’ils sont souvent incapables de les traduire en français, sinon d’une manière très approximative. Tel est le cas, par exemple, avec le vocabulaire de la musique et de la chanson « branchées » : beat, featuring, feedback, flow, groove, mastering, etc. L’adoption prématurée d’anglicismes est ici un facteur d’appauvrissement du lexique français : non seulement il entraine l’oubli de mots français parfaitement utiles et adaptés, mais il décourage la création de nouveaux mots français là où ils seraient nécessaires.
Enfin, l’anglicisation du français rend l’apprentissage de celui-ci plus difficile pour les non-francophones. On l’a noté plus haut, il y a de nombreuses années que l’on ne francise plus guère les emprunts à l’anglo-américain et que ceux-ci conservent à la fois leur graphie et leur prononciation d’origine – même si cette dernière devient souvent approximative. Ils constituent donc autant d’exceptions nouvelles aux règles de l’orthographe et de la phonétique françaises, sans oublier la morphologie (mise au pluriel, etc.), compliquant ainsi la tâche des apprenants. Cette difficulté n’est pas sans importance dans une ville-région comme Bruxelles, qui présente un caractère multiculturel accentué, et où les attentes des personnes issues de l’immigration sont très fortes à l’égard des formations en « français langue étrangère ».
Quelle réponse les autorités donnent-elles au phénomène d’anglicisation ? Bien que ce dernier soit manifestement plus intense à Bruxelles que dans les autres grandes villes francophones de Belgique, et si l’on excepte l’action modeste de la Maison de la Francité, il n’existe pas de politique bruxelloise spécifique en la matière. Les réactions les plus amples et les plus appropriées sont la création et la diffusion de bons équivalents français aux anglicismes, telles qu’elles sont assurées à Paris par la Commission générale de terminologie[4]. Cette diffusion est relayée par le Service de la langue (ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles), qui gère un répertoire terminologique considérable, mis en ligne sur Internet : toute personne qui désire connaitre l’équivalent français officiel à un mot anglais peut donc le consulter. Il faut néanmoins reconnaitre que cette ressource est encore peu connue des professionnels et du grand public, et qu’un gros effort de publicité devra être fait à l’avenir. 
- Voici deux autres écrits de Michèle Lenoble-Pinson publiés avant 1990 sur la question de l’anglicisation et des anglicismes : Le français à la sauce anglaise. Lexique des termes anglais et américains relevés en une année dans un grand quotidien bruxellois, 1982 ; Le message publicitaire et la langue française. Presse et affiches. Étude lexicale et syntaxique, 1987. [Retour]
- Le périodique, publié quatre fois l’an, est téléchargeable sur le site de la Maison de la Francité. [Retour]
- Ce texte est rédigé conformément aux rectifications orthographiques en vigueur. [Retour]
- NDLR Au Québec, ce service terminologique est assuré par l’Office québécois de la langue française, qui n’a pas d’équivalent en Belgique. [Retour]
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications