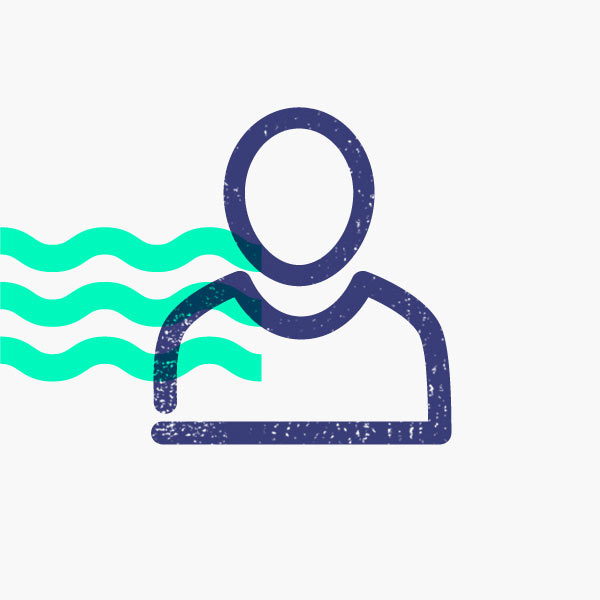L’enseignement de la littérature. Aspects critiques et historiques. Troisième partie: La réforme des programmes de 1993
La question de l’enseignement littéraire au Québec recoupe une problématique linguistique et nationale, ce qui n’a rien d’exceptionnel. La littérature y est au service de l’enseignement de la langue ; celle-ci constitue, pour ainsi dire, sa valeur première. Mais d’une époque à une autre, la littérature s’enrichit de significations et d’usages qui justifient sa présence dans les programmes scolaires. Nous avons décrit, dans des numéros précédents de Correspondance, la formation littéraire dans l’enseignement classique (1852-1967) et dans le régime d’enseignement collégial qui l’a remplacé (1967-1993). La formation classique s’est inspirée de la rhétorique, puis de l’histoire littéraire. Par la suite, la création des cégeps a favorisé de nouvelles orientations et un corpus d’œuvres contemporaines. Vers 1980, les théories du discours et de la communication ont imposé un paradigme critique et didactique qui a prévalu durant près de quinze ans. Dans le présent article, j’examinerai le contexte et les effets d’un nouveau programme d’enseignement du français adopté en 1993 et qui est resté en vigueur, moyennant quelques modifications[1]. En m’appuyant sur des recherches documentaires et sur des enquêtes auprès des enseignants et enseignantes, je veux apporter un éclairage singulier sur le sujet. Ces recherches permettent d’adopter une perspective critique et de susciter une réflexion sur les incidences pédagogiques et culturelles de cette « réforme ».
Les justifications d’une réforme
Beaucoup de questions que se posent les jeunes professeurs à propos de l’actuel programme d’enseignement ont préoccupé leurs prédécesseurs. Il est nécessaire de rappeler le contexte de la réforme pour comprendre ses raisons d’être et les réactions qu’elle a suscitées, mais aussi pour pouvoir juger des difficultés qui se font sentir de nos jours.
En 1990, plus de vingt ans après la création des cégeps, l’heure est aux bilans et à la critique. Il se passe peu de semaines sans que l’on dénonce, sur les tribunes et dans les journaux, la langue parlée et écrite des jeunes Québécois, en particulier des finissants des collèges. Les taux d’échec aux examens de français imposés à l’entrée par les universités semblent confirmer un préjugé tenace voulant que « les finissants du collège ne savent pas s’exprimer correctement ». L’opinion est discutable, mais la doxa est péremptoire. C’est devenu un lieu commun et une raison d’agir. Dès 1991, devant des collègues du réseau collégial réunis en colloque, un professeur de l’Université de Montréal, Jean Larose, condamne la culture pédagogique en cause,
celle-là même [dit-il] qui ne s’interroge pas sur elle-même, qui est à la fois la cause et l’effet non seulement de l’affaiblissement considérable de la littérature au collégial, mais de la dégradation de notre langue à travers le réseau national d’enseignement, et peut-être aussi de nos difficultés à franciser les immigrants, et peut-être encore de nos difficultés, originales et « distinctives », à devenir un peuple souverain[2].
On le voit, le sujet a pris des significations étonnantes. C’est dans cet esprit de contestation, mais sans reprendre nécessairement les positions de Jean Larose, que s’est amorcé le projet de renouvellement du programme d’études. En 1992, le Conseil des collèges, un organisme consultatif, soutient que le temps est venu de renouveler en profondeur le régime d’enseignement collégial. Une commission parlementaire prolonge cette réflexion qui aboutit à un projet de réforme, dit le Renouveau, et à la modification de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Limitant les consultations, le ministère de l’Éducation, alors dirigé par la ministre libérale Lucienne Robillard, a voulu faire diligence en imposant la réforme en 1993 peu avant le déclenchement des élections provinciales. Les textes officiels prévoient « des collèges pour le Québec du XXIe siècle » et ne manquent pas d’évoquer la mondialisation pour justifier les stratégies de changement :
La visée de fond du renouveau […] s’impose presque d’elle-même : il s’agit, dans un contexte mondial de plus en plus compétitif, d’assurer aux jeunes et à l’ensemble de la population du Québec un enseignement collégial d’un calibre et d’une qualité qui leur permettent de se mesurer aux meilleurs standards de compétence[3].
L’approche par compétences
Il faut se demander à quels principes obéit l’organisation d’un programme d’enseignement, à quels courants de pensée, voire à quelle mode elle est associée. Ce questionnement, qui a pu être estompé ou oublié, s’impose pour évaluer la pertinence des choix didactiques par rapport aux objectifs. Le Renouveau propose une nouvelle méthode pédagogique qui encadre toutes les activités d’enseignement au collégial. Cette méthode, communément appelée « approche par compétences », vise l’acquisition des habiletés nécessaires à l’accomplissement d’une tâche ou à l’exercice d’une profession. Une telle conception de la didactique s’applique assez bien aux programmes de formation technique ou professionnelle que dispensent les cégeps, alors qu’elle semble peu appropriée aux cours de formation générale, comme les cours de philosophie et de littérature.
L’origine et les raisons d’être de cette méthode sont éclairantes. En 1989, le rapport d’une délégation québécoise au Royaume-Uni décrit l’application et les résultats d’une importante réforme fondée sur cette méthode en Écosse et en Grande-Bretagne, au milieu des années quatre-vingt[4]. On y présente les avantages du nouveau système, notamment pour l’intégration des étudiants adultes et la « reconnaissance des acquis ». On mentionne également la possibilité d’une extension de la réforme à la formation générale et on évalue, enfin, la « pertinence des modèles du Royaume-Uni pour le Québec ». Pour les auteurs du rapport, ces modèles conviennent aux exigences de la « formation continue », y compris au perfectionnement de la main-d’œuvre. Mais il faut remonter plus loin encore pour trouver l’origine de l’approche par compétences. Dans une publication de la Fédération des cégeps, on peut lire que
[d]ans le domaine de l’enseignement postsecondaire, l’intérêt pour des programmes de formation définis à partir de la notion de compétence se serait d’abord manifesté aux États-Unis vers la fin des années 60 et le début des années 70. Connu sous le nom de competency-based education, ce courant de pensée aurait d’abord surgi dans le sillage de deux autres courants qui l’ont en quelque sorte précédé et lui ont préparé le terrain : le competency-based teacher education et le minimum competency testing[5].
Si la notion de compétence répond essentiellement à des exigences du marché du travail, elle n’est pas exclusive aux préoccupations professionnelles. Il semble qu’elle soit apparue particulièrement utile dans la perspective de l’évaluation des résultats scolaires. Dès 1987, par exemple, on emploie le terme pour désigner un ensemble de connaissances et d’habiletés à faire acquérir aux élèves pour assurer la qualité du français[6]. Il n’est pas étonnant, alors, de le voir apparaître dans les nouveaux programmes de français au primaire[7] et au secondaire[8]. Si son emploi est généralisé, c’est peut-être aussi par extension de sens que la notion de compétence s’est imposée dans le discours officiel sur l’éducation. Néanmoins, l’influence de la sphère professionnelle ressort toujours des visées officielles de l’enseignement collégial, lequel doit assurer à la fois la formation préuniversitaire et la préparation au marché du travail. Cela a nécessairement des conséquences sur l’enseignement et sur le statut de la langue et de la culture écrite.
Le programme de français
L’adoption de l’approche par compétences a déterminé une structure de cours particulière. Les correspondances et les différences avec le programme précédent méritent d’être soulignées. La nouvelle structure du programme de français au collégial, en 1993, comprend toujours quatre cours obligatoires, dont les trois premiers sont communs et le quatrième, spécifique des « concentrations » –comme on le disait à l’époque – (arts et lettres, sciences pures et appliquées, etc.). La différence la plus visible est le format des cours, qui passe de trois à quatre heures, y compris une période dite de laboratoire (d’une heure ou deux) pour des activités de rédaction encadrées. Leur valeur augmente en termes d’unités scolaires, par rapport à l’ancien programme. La « formation générale commune » prévoit également des cours de langue seconde, de philosophie – ou humanities pour les collèges anglophones – et d’éducation physique. Pour l’essentiel [écrit-on avec les instructions officielles],
le renouvellement de cette formation vise à assurer la maîtrise des langages fondamentaux, l’appropriation d’éléments importants de l’héritage toujours vivant de la culture ainsi que l’équilibre et l’intégration des divers aspects de la formation[9].
Dans le document intitulé Des collèges pour le Québec du XXIe siècle, document qui résume les objectifs, les standards et les activités d’apprentissage établis par le Règlement sur le régime des études collégiales, se trouve la description des nouveaux cours obligatoires de français, lesquels sont appelés des « Ensembles ». Sous la rubrique des « intentions éducatives en langue d’enseignement et littérature (français) », on précise que les trois premiers Ensembles – la formation générale commune – sont « conçus en une séquence présentant une logique pédagogique de cheminement gradué et continu des apprentissages. Formellement, l’Ensemble 1 est préalable à tous les autres, y compris à l’Ensemble de la composante de formation générale propre au programme. » Cela équivaut à la situation antérieure, où les cours étaient distribués selon une séquence. Par contre, le programme est nettement plus restrictif que le précédent, puisqu’il n’y a plus de banque de cours permettant à chaque département de français de construire son propre cursus. L’objectif de l’enseignement, quant à lui, est défini en termes de compétences à faire acquérir. Elles doivent être vérifiables, se traduire par des productions écrites et être mesurables au moyen d’un examen de sortie, l’Épreuve uniforme de français, qui sera institué en 1996 et qui deviendra une condition d’obtention du diplôme en 1998. Rappelons qu’un tel mode de sanction des études avait été abandonné avec la réforme de l’éducation dans les années 1960…
Les instructions de 1993 resserrent donc le programme des études d’un point de vue structurel ; elles le recentrent, par ailleurs, sur l’objet traditionnel, qui est la langue. La correction linguistique est explicitement une « préoccupation constante et soutenue, et elle s’actualise dans des productions signifiantes : analyse littéraire, dissertation, essai ». Le texte officiel ajoute : « L’application rigoureuse du code est le résultat ultimement recherché. » Les choses paraissent claires. Néanmoins, la littérature doit être bien présente dans cet enseignement. Il est précisé, en effet, que « les courants littéraires servent de toile de fond aux apprentissages langagiers et à l’acquisition des compétences intellectuelles ». Enfin, on peut lire le paragraphe qui suit dans le document ministériel de 1993 :
La fréquentation de la littérature inscrite dans des courants et des tendances aide l’élève à prendre connaissance des possibilités des variantes linguistiques de la langue commune. De plus, l’insertion des œuvres marquantes dans les courants et les tendances littéraires ouvre sur le dialogue des œuvres et des époques ; la nôtre actualise les sens de l’héritage culturel.
D’après ces énoncés, la littérature remplit une fonction d’illustration à l’égard de la « langue commune ». Compte tenu de la priorité accordée aux compétences linguistiques, elle a une valeur instrumentale. Par ailleurs, l’importance des courants littéraires signifie un retour à la catégorisation historique. La littérature au collège y retrouve une valeur référentielle. Enfin, derrière la formule du « dialogue des œuvres et des époques », dans le texte officiel, réapparaît le schème de la continuité à laquelle accordait préséance l’ancienne histoire littéraire.
Parallèlement, le programme d’études est défini en termes d’objectifs, c’est-à-dire de « compétences » à atteindre, de standards qui fixent des critères de performance, et d’activités d’apprentissage qui, curieusement, renvoient tout à la fois aux « techniques de compréhension de texte », aux « thématiques et procédés stylistiques de courants littéraires », à la « notion de plans » et à la « présentation matérielle de travaux écrits ». Les instructions renferment, par ailleurs, peu d’indications sur le corpus enseigné, mais elles engagent à respecter la chronologie et les courants littéraires.
Les contenus des cours obligatoires
Étant donné le lectorat auquel est destinée la présente publication, je ne décrirai pas les cours obligatoires de langue et littérature. Il faudrait rappeler, cependant, que la version initiale du programme comportait plus de contraintes que sa version actuelle : elle exigeait notamment, dans le troisième Ensemble, la comparaison d’une œuvre de la littérature québécoise et d’une autre de la littérature française, et la rédaction d’un « essai critique d’un minimum de 1250 mots ». En l’occurrence, la nécessité de « se situer par rapport aux œuvres québécoises », inscrite dans l’état premier du programme, a été rapidement supprimée. Avec le temps, on abrège les productions écrites et on propose de nouvelles désignations : le commentaire composé côtoie ou remplace l’analyse littéraire (700 mots), tandis que la dissertation devient la dissertation explicative (800 mots) et l’essai, la dissertation critique (900 mots), sans que soient profondément transformés la nature et les buts de ces exercices. Pour sa part, le quatrième Ensemble, conçu à l’origine comme un cours général de français, est devenu effectivement un cours de consolidation des habiletés linguistiques, mais parfois aussi un autre cours de littérature, et particulièrement de littérature étrangère. Dans les faits, cela varie d’un collège à un autre.
Par le type de productions qu’ils impliquent, les trois premiers Ensembles assurent une progression des apprentissages pratiques. C’était du moins l’intention du programme. Mais était-ce bien sérieux et réalisable ? Si le but recherché était un taux de réussite élevé à l’examen ministériel, le programme pouvait se réduire à une suite d’épreuves de rédaction, dont l’efficacité dernière serait l’émission de diplômes. Or, compte tenu des contenus théoriques, historiques et critiques des cours, qui, sans être prioritaires, ont une importance affichée dans les instructions officielles, le programme de 1993 apparaît démesuré. On essaie de dispenser en trois cours à peine – 180 heures au total – une formation littéraire générale, qui inclut la connaissance des œuvres françaises du Moyen Âge jusqu’à nos jours et des littératures québécoise et francophone contemporaines. Depuis 1994, du reste, les professeurs s’en plaignent, qui avouent devoir sacrifier les contenus aux exercices préparatoires à l’examen ministériel. Si leurs plaintes restent vaines, c’est peut-être parce que les contenus ont peu d’importance, moins en tout cas que les faits mesurables.
Pour leur part, les types de rédactions exigés ne manquent pas de faire penser aux exercices des classes de belles-lettres et de rhétorique d’autrefois. Le retour de pratiques éprouvées et d’un examen de composition terminal indique assez bien l’orientation de la réforme. Celle-ci présuppose sinon une nostalgie, du moins une valorisation des humanités classiques. Dans cet univers déjà ancien, les analyses et les dissertations, auxquelles les élèves des collèges classiques s’exerçaient durant des années, tenaient un rôle primordial dans l’établissement de consensus et de communautés interprétatives ; elles constituaient un instrument et un reflet de l’institution littéraire. Il y a donc lieu de se questionner sur les innovations effectives de ce Renouveau : quelle littérature, quelle conception de la culture prétendait-il transmettre ? Quinze ans après la réforme, la question se pose.
L’application du programme dans les collèges
Pour se faire une idée précise des cours donnés dans le cadre du Renouveau, il faut s’en remettre aux propositions des enseignants et enseignantes et aux documents départementaux. C’est ce qu’ont permis des enquêtes ponctuelles et une recherche approfondie sur la période de 1990 à 1996[10]. Grâce à une documentation de plusieurs centaines de plans de cours en provenance d’un échantillon représentatif de collèges, on peut constater que, globalement, l’enseignement collégial a toujours comporté des contenus littéraires, au moins par la mention d’œuvres données à lire.
Dans le nouveau programme, tous les collèges que nous avons consultés en 1996 adoptaient le découpage historique implicite de l’énoncé ministériel, faisant appel à des manuels de littérature et à des anthologies. Toutefois, le découpage variait sensiblement d’un établissement à un autre. Ainsi, l’Ensemble 1 recouvrait la littérature des origines ou du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle et, par exception, jusqu’à 1900. Le corpus au programme dans l’Ensemble 2 était plus diversifié : il s’agissait tantôt des œuvres des XVIIIe et XIXe siècles, tantôt de celles des XIXe et XXe siècles, ou encore, du XXe siècle uniquement. Dans un cas, cependant, le département de français avait clairement choisi de « privilégier la connaissance de la littérature nationale, puis en second lieu, la connaissance des littératures d’expression française », ce qui avait pour effet de reporter les contenus de « l’héritage littéraire français » (à partir du romantisme jusqu’au XXe siècle) dans le cours de l’Ensemble 2. L’Ensemble 3 était – est encore – généralement consacré à la littérature du Québec, comme cela était prévu. Quant à l’Ensemble 4, en 1995-1996, quelques départements y incluaient – en dépit des instructions – l’enseignement d’œuvres littéraires, dont certains en insistant sur la littérature québécoise. C’est que le nouveau programme bousculait les habitudes et qu’il est apparu impossible de rendre compte du corpus québécois dans un seul cours. Par ailleurs, un département de français avait jugé bon d’offrir, dans l’Ensemble 4, le choix parmi les anciens cours entre le volet « Communications et média », non littéraire, et le cours « Théâtre et communication », axé sur la pratique et impliquant quatre sorties pendant le trimestre. À ce sujet, il faudrait souligner la disparition des cours de théâtre, parmi les cours obligatoires, et les inquiétudes qu’elle a suscitées, à ce moment, chez les professeurs et les gens du milieu théâtral.
Les corpus nationaux
On peut remarquer, jusqu’en 1994, une importance relative accordée à la littérature québécoise, mais non une priorisation du corpus national, comme certains observateurs se sont permis de l’affirmer. Il semble, d’ailleurs, que la réforme du programme de français de 1993 ait fait sienne cette opinion ou, en tout cas, qu’elle ait reconduit une fausseté. En réalité, la culture québécoise n’a jamais été une priorité dans l’enseignement du français au collégial et elle n’a pas remplacé la littérature française, bien qu’il se trouvât, de façon sporadique, une représentation plus grande du corpus national dans la décennie 1970. Depuis la création des cégeps, il y a donc eu un véritable élargissement parmi les représentations culturelles. Dans la décennie 1980, un équilibre relatif s’est établi entre l’importance dévolue à la littérature québécoise et celle accordée aux littératures d’autres provenances. Cet équilibre était rompu dans l’énoncé du nouveau programme de 1993. Entre 1990 et 1994, la représentation de la littérature québécoise a varié de 43,2 à 52,1 % des œuvres enseignées, tandis que, dans les cours du nouveau programme, de 1994 à 1996, elle a atteint une moyenne de 32,6 %. Un seul des quatre nouveaux cours obligatoires de français lui réservait alors une place explicite, mais encore, en proposant une comparaison avec les autres littératures francophones. Cette situation rappelle une réalité d’autrefois où la littérature française, celle du XVIIe siècle surtout, était à l’honneur dans les collèges classiques.Quels étaient les auteurs et les œuvres enseignés au moment de l’implantation du nouveau programme de 1993 ? Du côté québécois, les noms d’Anne Hébert et de Michel Tremblay se distinguaient, tandis que Molière et Albert Camus dominaient en nombre absolu. Entre autres choses, l’ancien programme semblait encourager sinon autoriser l’inclusion de nouveaux écrivains et de pratiques diversifiées dans le corpus scolaire, alors que le nouveau programme ne s’y prêtait guère, du moins au début. De même, la place des écrivains étrangers, modeste jusque-là, était plus que compromise, puisque les œuvres en traduction étaient exclues.
Avec le nouveau programme, il semble que l’on ait fait table rase de l’expérience acquise depuis 1967 et que l’on ait cherché à imposer de nouveau la tradition scolaire, et ce, par l’enseignement des courants littéraires, des auteurs classiques et des exercices d’analyse et de dissertation – lesquels étaient typiques de la formation classique. Les effets prévisibles en étaient importants, dont le plus insidieux, peut-être, était d’établir un clivage entre un environnement et un héritage culturels. Il en résultait aussi un écart accru entre la culture vivante et la culture scolaire.
La révision du programme de 1998
La situation a beaucoup changé depuis 1993, bien que les orientations générales du programme soient semblables. Le ministère de l’Éducation a apparemment tenu compte des inquiétudes et des protestations du corps professoral, nombreuses au début, en proposant, cinq ans après la réforme, une version remaniée du programme. Celle-ci apportait quelques précisions, éliminait des irritants, et surtout, laissait plus de liberté de choix dans les corpus. Il est possible, depuis, d’enseigner des genres variés, de différentes époques et même des œuvres étrangères (en traduction). La littérature québécoise reste l’objet spécifique de l’Ensemble 3 et elle peut être comparée à un corpus de toute origine, ce qui est un assouplissement du programme de 1993. Les exercices de rédaction, quant à eux, ont été quelque peu modifiés et abrégés. Enfin, l’imposition, en 1998, de l’Épreuve uniforme de français comme exigence d’obtention du diplôme a entraîné une responsabilité additionnelle dans l’enseignement du troisième Ensemble : il s’est agi dès lors de préparer les élèves à l’examen ministériel, ce qui n’était pas pour simplifier la tâche des enseignants. Cela ne pose pas moins de problèmes aujourd’hui.
Cependant, les enseignants semblent s’être peu à peu réapproprié la matière en fonction de leurs compétences et de leurs préférences. Bien malin qui pourrait dire quels sont, de nos jours, les œuvres et les auteurs dominants. Bien sûr, il est le plus souvent sinon toujours question des classiques et de Molière, des Lumières et de Voltaire, des naturalistes et de Zola, etc. Mais des écrivains venus d’ailleurs, des contemporains, de nouvelles voix s’imposent un peu partout. Paradoxalement, les grands courants littéraires français servent encore de toile de fond à l’étude des œuvres. La question n’est pas de savoir s’ils doivent être enseignés, mais s’ils peuvent conserver quelque pertinence en l’absence d’un corpus représentatif… et substantiel. En l’occurrence, le Renouveau a mis en évidence une disproportion entre une fin et des moyens, c’est-à-dire entre la transmission d’un héritage culturel et une somme nécessairement limitée de connaissances et de pratiques…

La première caractéristique du programme de 1993 était la réapparition dans le discours didactique des courants littéraires, lesquels correspondent souvent aux catégories de l’histoire (Renaissance, Classicisme, Lumières, etc.) et plus particulièrement à celles de l’histoire de la littérature française (naturalisme, romantisme, symbolisme, etc.). L’époque contemporaine et la production québécoise commandent évidemment de nouvelles désignations. Après avoir subi une perte de valeur notoire dans le discours critique et scolaire, le « courant » redevient pour la littérature un interprétant, au sens peircéen du terme[11]. Les considérations historiques ou esthétiques qu’il appelle, le cas échéant, l’emportent sur les considérations sociologiques. On peut y voir un retour à la méthode de l’histoire littéraire et un encouragement à la fréquentation des morceaux choisis, ce qui était confirmé dans les instructions officielles de 1993 par la mention d’une anthologie pour chacun des cours.
Une deuxième caractéristique du programme de 1993 était de créer une grande homogénéité de contenus. Malgré ses ouvertures et une prise de liberté de la part des professeurs, le programme officiel reflète encore, de nos jours, la tradition scolaire, laquelle est redevenue un signe de la culture littéraire et en assure, pour ainsi dire, l’uniformité et la valeur d’échange. C’était, en 1993, une réaction sans équivoque à l’effet de dispersion des cours de l’ancien programme, réaction que l’opinion courante, détachée du milieu, a jugée inconsistante.
Enfin, l’imposition d’un examen à la fin des études collégiales a justifié « l’approche par compétences » dans le nouveau programme, ce qui indiquait que l’objectif n’était pas tant le développement de savoirs littéraires que l’uniformisation des habiletés techniques. Même en reconnaissant l’intérêt des exercices d’analyse et de dissertation, il faut se demander si l’on n’a pas négligé la perspective du sujet enseigné dans ce programme. Qu’advient-il de la motivation à la lecture[12] ? Et que dire de l’enseignant qui se voit obligé de combler dans un même cours de belles-lettres et de composition l’ignorance de ses étudiants en matière d’histoire ? Dans le nouveau programme, en somme, les visées cognitives et affectives de la didactique littéraire s’évanouissent au profit d’une finalité pragmatique, dont le premier mérite est d’attester devant l’opinion publique que le ministère de l’Éducation, en période de crise ou de délire, a assumé ses responsabilités.

- Je reprends ici plusieurs éléments de textes que j’ai publiés sur le sujet, dont principalement « La réforme de l’enseignement collégial au Québec : vers des compétences littéraires communes », dans Enjeux, Revue de didactique du français (CEDOCEF, Namur), numéros 43-44, 1998/mars 1999, p. 160-190. [Retour]
- Jean LAROSE, « La littérature à distance. Sur la culture pédagogique québécoise », dans : [Collectif] Colloque 1991 : le français au collégial, Jonquière, Collège de Jonquière, 1991, p. 20-21. [Retour]
- MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, « Des collèges pour le Québec du XXIe siècle », Fine pointe, volume 8, numéro spécial, avril 1993, p. 14. [Retour]
- Robert ISABELLE, Une révolution tranquille au Royaume-Uni : de nouveaux systèmes de formation et de qualification professionnelles centrés sur les compétences, Rapport de mission, Fonds pour l’implantation de la reconnaissance des acquis au collégial, Montréal, Fédération des cégeps, 1989, 180 p. (Études et réflexions ; 19). [Retour]
- Gilles TREMBLAY, À propos des compétences comme principe d’organisation d’une formation. Éléments de réflexion théorique et perspectives historiques, Bulletin d’information, Fonds pour l’implantation de la reconnaissance des acquis au collégial, Montréal, Fédération des cégeps, volume 6, numéro 9, avril 1990, p. 3. [Retour]
- CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, La qualité du français à l’école : une responsabilité partagée, Avis au ministre de l’Éducation, Québec, Gouvernement du Québec, 1987, p. 15. [Retour]
- MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, Programme d’études. Le français, enseignement primaire, Québec, Gouvernement du Québec, 1993, p. 3. [Retour]
- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Programme d’études. Le français, enseignement secondaire, Québec, Gouvernement du Québec, 1995, p. 2. [Retour]
- MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, Des collèges pour le Québec du XXIe siècle. Formation générale, Québec, Gouvernement du Québec, 1993. [Retour]
- Max ROY, Enseignement collégial, littérature québécoise et théâtre au Québec, Rapport de recherche, Montréal, UQAM, 1997, 106 p. Repris sous forme de livre : La littérature québécoise au collège (1990-1996), Montréal, XYZ éditeur, 1998, Coll. Documents, 104 p. [Retour]
- Dans la théorie sémiotique de Charles S. Peirce, l’interprétant est un signe d’un autre signe qu’il permet de reconnaître, de comprendre et de délimiter. Ainsi, nous pouvons dire que le « courant » est un signe, un indice ou un trait pertinent de ce qui est du domaine littéraire, de ce qui peut en faire partie et de ce qu’on peut juger comme tel. [Retour]
- Au cours des dernières années, j’ai supervisé des enquêtes sur la lecture des élèves des ordres secondaire et collégial. Certains résultats ont paru dans un ouvrage collectif : Max ROY, Marilyn BRAULT et Sylvain BREHM, dir., Formation des lecteurs. Formation de l’imaginaire, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, 2008, Coll. Figura, 200 p. [Retour]
Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications